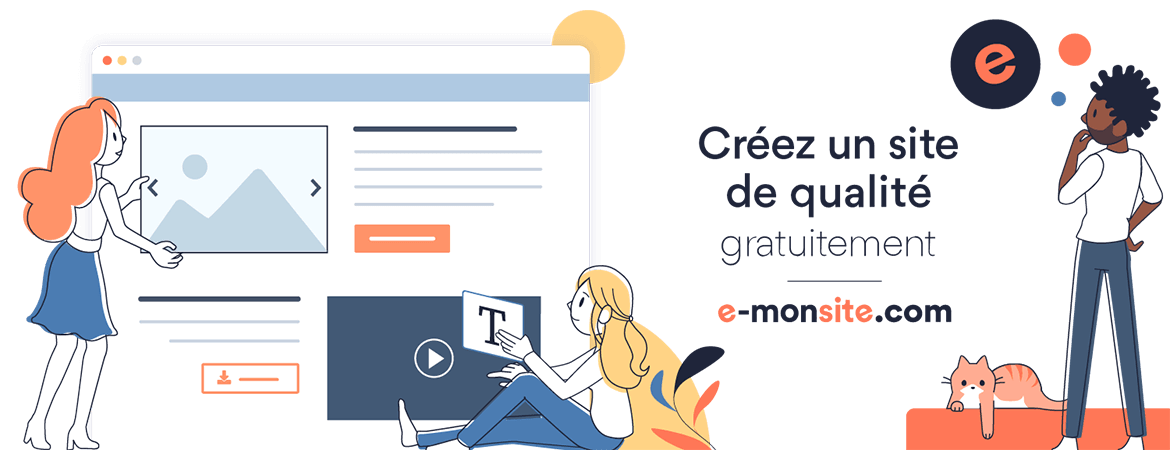- Accueil
- BIBLIOTHEQUE VIRTUELLE
- Auteurs actuels
- Père Raniero Cantalamessa
- Textes Raniero Cantalamessa 2006
Textes Raniero Cantalamessa 2006
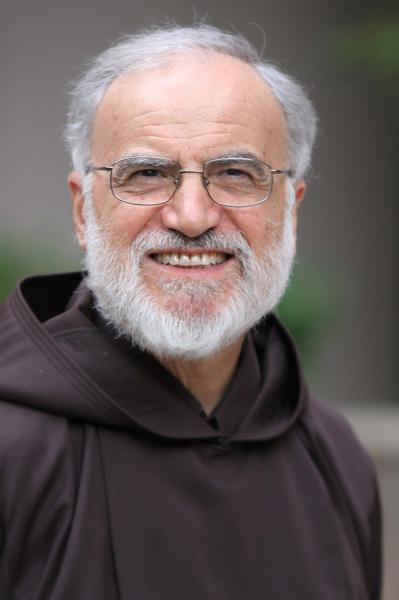
Père Raniero Cantalamessa
Liste des textes
................
Deuxième prédication de Carême 2010: Le Christ s'est offert lui-même à Dieu
Prédication du Vendredi saint 2010 Nous avons un grand prêtre souverain
Méditation de Careme, Vatican 2006: Il apprit de ses souffrances, l’obéissance
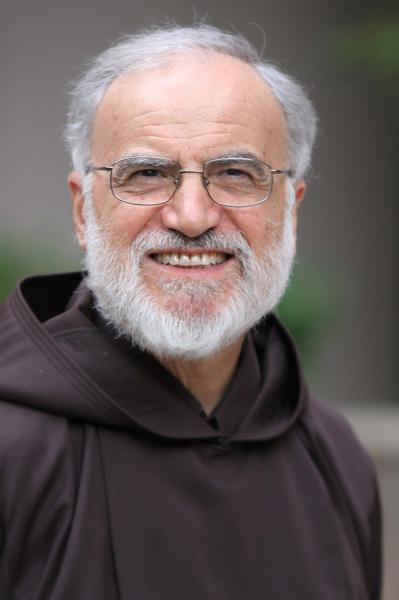
Père Raniero Cantalamessa
Deuxième prédication de Carême 2010: Le Christ s'est offert lui-même à Dieu
1. La nouveauté du sacerdoce du Christ
Dans cette méditation, nous voulons réfléchir sur le prêtre en tant que dispensateur des ‘mystères' de Dieu, entendus cette fois dans le sens des signes concrets de la grâce, les sacrements. Ne pouvant pas nous arrêter sur tous les sacrements, nous nous limiterons au sacrement par excellence : l'Eucharistie, comme le fait aussi Presbyterorum Ordinis qui, après avoir parlé des prêtres comme évangélisateurs, poursuit en déclarant que « leur ministère, commençant par l'annonce de l'Évangile, tire sa force et sa puissance du sacrifice du Christ » qu'ils renouvellent mystiquement sur l'autel 1.
Ces deux fonctions du prêtre sont celles que les apôtres se sont attribuées : « quant à nous, déclare Pierre dans les Actes, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole » (Ac 6, 4). La prière dont il parle n'est pas la prière personnelle ; mais la prière liturgique communautaire, centrée sur la fraction du pain. La Didachè permet de voir comment, dans les premiers temps, l'Eucharistie était offerte dans le contexte de la prière de la communauté, comme faisant partie de celle-ci, comme son sommet 2.
De même que le sacrifice de la Messe ne peut se comprendre indépendamment du sacrifice de la Croix, le sacerdoce chrétien ne s'explique que en dépendance et comme participation sacramentelle au sacerdoce du Christ. C'est de là qu'il nous faut partir pour découvrir la caractéristique fondamentale et les qualités essentielles du sacerdoce ministériel.
La nouveauté du sacrifice du Christ par rapport au sacerdoce de l'ancienne alliance (et, comme nous le savons aujourd'hui, par rapport à toute autre institution sacerdotale également en dehors de la Bible) est mise en relief par divers points de vue, dans l'Epître aux Hébreux : le Christ n'a pas eu besoin d'offrir des victimes d'abord pour ses propres péchés comme les autres prêtres, (7, 27) ; il n'a pas eu besoin de renouveler plusieurs fois le sacrifice, mais « une fois pour toutes, à la fin des temps, il s'est manifesté pour abolir le péché par son sacrifice » (9, 26). Toutefois, la différence fondamentale est autre. Entendons comment elle est décrite :
« Le Christ, lui, survenu comme un grand prêtre des biens à venir [...] entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption éternelle. Si en effet du sang de boucs et de taureaux et de la cendre de génisse, dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifient en leur procurant la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par un Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant ! » (He 9, 11-14).
Les autres prêtres offrent tous quelque chose qui se trouve en dehors d'eux-mêmes, le Christ s'est offert lui-même ; tous les autres prêtres offrent des victimes, le Christ, lui, s'est offert en victime ! Saint Augustin a résumé dans une formule célèbre ce nouveau genre de sacerdoce, dans lequel prêtre et victime ne font qu'un : « Ideo victor, quia victima, et ideo sacerdos, quia sacrificium » : vainqueur parce que victime, prêtre parce que victime » 3.
Dans le passage des sacrifices anciens au sacrifice du Christ, on observe la même nouveauté que dans le passage de la loi à la grâce, du devoir au don, illustrée dans une précédente méditation. D'abord œuvre de l'homme pour apaiser la divinité et se la réconcilier, le sacrifice passe à être don de Dieu pour apaiser l'homme, le faire abandonner sa violence et se réconcilier avec lui-même (cf. Col 1, 20). Dans son sacrifice, comme dans tout le reste, le Christ est « totalement autre ».
2. « Imitez ce que vous opérez »
La conséquence de tout cela est claire : pour être prêtre « selon l'ordre de Jésus-Christ », le prêtre doit, comme lui, s'offrir lui-même. Sur l'autel, il ne représente pas seulement le Jésus « prêtre suprême », mais aussi le Jésus « victime suprême », les deux étant désormais inséparablement liés. En d'autres termes, il ne peut pas se contenter d'offrir le Christ au Père dans les signes sacramentaux du pain et du vin, il doit également s'offrir lui-même avec le Christ au Père. Reprenant une pensée de saint Augustin, l'instruction et la Sacrée Congrégation des rites, Eucharisticum mysterium, énonce : « Quant à l'Eglise, épouse et servante du Christ, en accomplissant avec lui l'office de prêtre et de victime, elle l'offre au Père et en même temps elle s'offre tout entière avec lui » 4.
Ce qui est dit ici de l'Eglise tout entière, s'applique tout particulièrement au célébrant. Lors de l'ordination, l'évêque exhorte les ordinands : « Agnoscite quod agitis, imitamini quod tractatis » : « Considérez ce que vous faites ; imitez ce que vous opérez ». En d'autres termes, fais ce que fait le Christ dans la Messe, c'est-à-dire offre-toi toi-même à Dieu en sacrifice vivant. Saint Grégoire de Naziance écrit :
« Sachant que personne n'est digne de la grandeur de Dieu, de la Victime et du Prêtre, s'il ne s'est pas offert d'abord lui-même comme sacrifice vivant et saint, s'il ne s'est pas présenté comme oblation raisonnable et agréable (cf. Rm 12, 1) et s'il n'a pas offert à Dieu un sacrifice de louange et un esprit contrit - l'unique sacrifice dont l'auteur de tout don demande l'offrande -, comment oserai-je lui offrir l'offrande extérieure sur l'autel, celle qui est la représentation des grands mystères » 5.
Pour vous aider à mieux comprendre, je me permets de raconter comment j'ai moi-même découvert cette dimension de mon sacerdoce. Après mon ordination, voici comment je vivais le moment de la consécration : je fermais les yeux, penchais la tête, et cherchais à me couper de tout ce qui m'entourait pour m'identifier à Jésus qui, au cénacle, prononça pour la première fois ces paroles : « Accipite et manducate... », « Prenez et mangez-en... ».
La liturgie elle-même favorisait cette attitude, faisant prononcer les paroles de la consécration à voix basse et en latin, penchés sur les espèces, tournés vers l'autel et non face au peuple. Puis, un jour, j'ai compris qu'une telle attitude, à elle seule, n'exprimait pas tout le sens de ma participation à la consécration. Celui qui préside de manière invisible à chaque Messe est le Jésus ressuscité, le Vivant ; le Jésus, pour être exact, qui était mort, mais est désormais vivant pour les siècles des siècles (cf. Ap 1, 18). Mais ce Jésus est le « Christ total », Tête et corps indissolublement unis. Donc, si c'est ce Christ total qui prononce les paroles de la consécration, moi aussi je les prononce avec lui. Dans le « Moi » (avec un M majuscule) de la Tête, il y a caché le petit « moi » (avec un m minuscule) du corps qui est l'Eglise, il y a aussi mon tout petit « moi ».
Depuis ce jour, au moment où, en tant que prêtre ordonné par l'Eglise, je prononce les paroles de la consécration « in persona Christi », en croyant que, grâce à l'Esprit Saint, elles ont le pouvoir de changer le pain en le corps du Christ et le vin en son sang, en même temps, en tant que corps du Christ, je ne ferme plus les yeux, mais je regarde les frères qui sont devant moi ; ou, si je célèbre seul, je pense à ceux que je dois servir durant la journée et, tourné vers eux, je dis mentalement, avec Jésus : « Frères et soeurs, prenez et mangez-en : Ceci est mon corps ; prenez et buvez-en, Ceci est mon sang ».
Par la suite, j'ai trouvé une curieuse confirmation dans les écrits de la vénérable Concepciòn Cabrera de Armida, dite Conchita, la mystique mexicaine fondatrice de trois ordres religieux, dont le procès de béatification est en cours. A son fils jésuite, sur le point d'être ordonné prêtre, elle écrivait :
« Souviens-toi, mon fils, lorsque tu tiendras dans tes mains la Sainte-Hostie, tu ne diras pas : ‘Voici le Corps de Jésus' et ‘voici son sang', mais tu diras : ‘Ceci est mon Corps' et ‘Ceci est mon sang', c'est-à-dire que doit s'opérer en toi une totale transformation, tu dois te perdre en Lui, être ‘un autre Jésus' » 6.
L'offrande du prêtre et de toute l'Eglise, sans celle de Jésus, ne serait ni sainte, ni agréable à Dieu, car nous ne sommes que des créatures pécheresses ; mais l'offrande de Jésus, sans celle de son corps qui est l'Eglise, serait elle aussi incomplète et insuffisante : non, bien entendu, pour procurer le salut, mais pour que nous la recevions et que nous nous l'approprions. C'est dans ce sens que l'Eglise peut dire avec saint Paul : « Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ » (cf. Col 1, 24).
Nous pouvons illustrer par un exemple ce qui se passe à chaque Messe. Imaginons que dans une famille un des fils, l'aîné, aime particulièrement son père. Il souhaite lui faire un cadeau pour son anniversaire. Mais avant de le lui présenter, il demande, en secret, à tous ses frères et soeurs d'apposer leur signature sur le cadeau. Celui-ci arrive dans les mains du père comme l'hommage indistinct de tous ses enfants et comme un signe de l'estime et de l'amour de tous, mais en réalité, un seul en a payé le prix.
Et, maintenant, l'application. Jésus admire et aime infiniment le Père céleste. Il veut lui faire chaque jour, jusqu'à la fin du monde, le don le plus précieux que l'on puisse imaginer, celui de sa vie même. A la Messe, il invite tous ses « frères », c'est-à-dire nous, à apposer leur signature sur le don, de sorte que celui-ci parvienne à Dieu le Père comme le don indistinct de tous ses enfants, « mon et votre sacrifice (mon sacrifice qui est aussi le vôtre) », comme récite le prêtre dans l'Orate fratres. Mais, en réalité, nous savons qu'un seul a payé le prix d'un tel don. Et quel prix !
3. Le corps et le sang
Pour comprendre les conséquences pratiques qui découlent de tout cela pour le prêtre, il faut tenir compte du sens du mot « corps » et du mot « sang ». Dans le langage biblique, le mot corps, comme le mot chair, ne désigne pas, comme pour nous aujourd'hui, une des trois parties de la personne comme dans la trichotomie grecque (corps, âme, esprit) ; il désigne la personne toute entière, en tant que vivant dans une dimension corporelle (« Le Verbe s'est fait chair », signifie s'est fait homme, non pas os, muscles, nerfs !). A son tour, « sang » ne désigne pas une partie d'une partie de l'homme. Le sang est le siège de la vie, c'est pourquoi l'effusion de sang est signe de la mort.
Avec le mot « corps », Jésus nous a donné sa vie, avec le mot « sang », il nous a donné sa mort. Appliqué à nous, offrir le corps signifie offrir le temps, les ressources physiques, mentales, un sourire qui est typique d'un esprit qui vit dans un corps ; offrir le sang signifie offrir la mort. Non seulement le dernier moment de la vie, mais tout ce qui, dès à présent, anticipe la mort : les mortifications, les maladies, les passivités, tout le négatif de la vie.
Essayons d'imaginer la vie sacerdotale vécue dans cette conscience. Toute la journée, et pas seulement le moment de la célébration, est une eucharistie : enseigner, gérer, confesser, visiter les malades, même le repos, même la détente, tout. Un maître spirituel, le jésuite français Pierre Olivaint, disait : « Le matin, moi prêtre, Lui victime [à l'époque on ne célébrait la messe que le matin] ; le long du jour Lui prêtre, moi victime. Et le Saint Curé d'Ars s'exclamait « Oh ! qu'un prêtre fait bien de s'offrir à Dieu en sacrifice tous les matins » ! » 7.
Grâce à l'eucharistie, même la vie du prêtre âgé, malade, et réduit à l'immobilité, est infiniment précieuse pour l'Eglise. Il offre « le sang ». J'ai rendu visite un jour à un prêtre atteint d'une tumeur. Il se préparait à célébrer une de ses dernières messes avec l'aide d'un jeune prêtre. Il avait également une maladie des yeux qui faisait que ses yeux larmoyaient continuellement. Il m'a dit : « Je n'avais jamais compris l'importance de dire également, en mon nom, à la Messe : « Prenez et mangez ; prenez et buvez ... ». A présent, je l'ai compris. C'est tout ce qui me reste et je le dis sans arrêt en pensant à mes paroissiens. J'ai compris ce que veut dire être « pain rompu » pour les autres.
4. Au service du sacerdoce universel des fidèles
Une fois découverte cette dimension existentielle de l'Eucharistie, la fonction pastorale du prêtre va consister à aider les membres du peuple de Dieu à la vivre. L'année sacerdotale ne devrait pas rester une opportunité et une grâce uniquement pour les prêtres, mais aussi pour les laïcs. Le décret Presbyterorum ordinis affirme clairement que le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce universel de tous les baptisés, afin qu'ils « s'offrent eux-mêmes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu (Rm 12, 1). En effet :
« C'est par le ministère des prêtres que se consomme le sacrifice spirituel des chrétiens, en union avec le sacrifice du Christ, l'unique Médiateur, offert au nom de toute l'Église dans l'Eucharistie par les mains des prêtres, de manière non sanglante et sacramentelle, jusqu'à ce que vienne le Seigneur lui-même » 8.
La Constitution Lumen gentium du Concile Vatican II, à propos du « sacerdoce commun » de tous les fidèles, écrit :
« les fidèles eux, de par le sacerdoce royal qui est le leur, concourent à l'offrande de l'Eucharistie... Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils offrent à Dieu la victime divine et s'offrent eux-mêmes avec elle ; ainsi, tant par l'oblation que par la sainte communion, tous, non pas indifféremment mais chacun à sa manière, prennent leur part originale dans l'action liturgique » 9 .
L'Eucharistie est donc l'acte de tout le peuple de Dieu, pas seulement au sens passif, qui profite à tous, mais également actif, en ce sens qu'il s'accomplit avec la participation de tous. On trouve le fondement biblique le plus clair de cette doctrine dans Romains 12, 1 : « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu : c'est là le culte spirituel que vous avez à rendre ».
Commentant ces paroles de Paul, saint Pierre Chrysologue, déclarait :
« L'apôtre en demandant cela élève tous les hommes à la dignité sacerdotale. A offrir leurs corps en hostie vivante. Ô dignité inouïe du sacerdoce chrétien, puisque l'homme est à la fois l'hostie et le prêtre. Il ne cherche plus à l'extérieur ce qu'il doit immoler à Dieu ; il apporte avec lui et en lui ce que, pour lui-même, il va sacrifier à Dieu... Frères, ce sacrifice jaillit du modèle du Christ... Deviens, homme, deviens le sacrifice de Dieu et son prêtre » 10.
Essayons de voir comment la manière de vivre la consécration que j'ai illustrée pourrait aider également les laïcs à s'unir à l'offrande du prêtre. Le laïc lui aussi est appelé, nous l'avons vu, à s'offrir au Christ, dans la Messe. Peut-il le faire en utilisant les paroles mêmes du Christ : « Prenez et mangez-en, ceci est mon corps » ? Je pense que rien ne s'y oppose. Ne faisons-nous pas la même chose quand, pour exprimer notre abandon à la volonté de Dieu, nous employons les paroles de Jésus sur la croix : « Père, en tes mains je remets mon esprit », ou quand, dans nos épreuves, nous répétons : « que ce calice s'éloigne de moi ! », ou d'autres paroles du Sauveur ? Employer les paroles du Christ aide à s'unir à ses sentiments.
La mystique mexicaine, mentionnée plus haut, sentait que les paroles du Christ s'adressaient aussi à elle, pas seulement à son fils : « « Je veux que transformé en Moi par la souffrance, par l'amour et par la pratique de toutes les vertus, monte vers le ciel ce cri de ton âme en union avec Moi : ‘Ceci est mon Corps' et ‘Ceci est mon Sang' » 11.
Le fidèle laïc doit seulement être bien conscient que ces paroles qu'il dit, à la Messe ou durant le jour, n'ont pas le pouvoir de rendre présent le corps et le sang du Christ sur l'autel. A ce moment-là, il n'agit pas in persona Christi ; il ne représente pas le Christ, comme le prêtre ordonné, il ne fait que s'unir au Christ. C'est pourquoi, il ne prononcera pas les paroles de la consécration à voix haute, comme le prêtre, mais dans son coeur, en les pensant plus qu'en les disant.
Imaginons ce qui se passerait si les laïcs eux aussi, au moment de la consécration, disaient silencieusement : « Prenez et mangez-en : ceci est mon corps. Prenez et buvez-en : ceci est mon sang ». Une mère de famille célèbre ainsi sa Messe, puis va chez elle et commence sa journée faite de mille petites choses. Sa vie est littéralement émiettée ; apparemment elle ne laisse aucune trace dans l'histoire. Or ce qu'elle fait, ce n'est pas rien : c'est une eucharistie avec Jésus ! Une religieuse dit elle aussi, dans son coeur, au moment de la consécration : « Prenez, mangez... » ; ensuite elle vaque à son travail quotidien : enfants, malades, personnes âgées. L'Eucharistie « envahit » sa journée qui devient comme un prolongement de l'Eucharistie.
Mais j'aimerais m'arrêter en particulier sur deux catégories de personnes : les travailleurs et les jeunes. Le pain eucharistique « fruit de la terre et du travail des hommes », a quelque chose d'important à nous dire sur le travail humain, et pas seulement agricole. Dans le processus qui va du grain semé en terre au pain sur la table, intervient l'industrie avec ses machines, le commerce, les transports et une infinité d'autres activités, concrètement tout le travail de l'homme. Enseignons au travailleur chrétien à offrir, à la Messe, son corps et son sang, c'est-à-dire son temps, sa sueur, sa fatigue. Le travail ne sera plus aliénant comme dans la vision marxiste selon laquelle il finit dans le produit qui est vendu, mais sanctifiant.
Et qu'est-ce que l'eucharistie a à dire aux jeunes ? Il suffit de penser à une chose : que veut le monde des jeunes gens et des jeunes filles, aujourd'hui ? Le corps, rien d'autre que le corps ! Le corps, dans la mentalité du monde, est essentiellement un instrument de plaisir et de jouissance. Une chose à vendre, à exploiter tant qu'on est jeune et séduisant, et dont on se débarrassera ensuite, avec la personne, quand il ne servira plus à ces fins. Le corps de la femme, tout particulièrement, est devenu un article de consommation.
Enseignons aux jeunes chrétiens, garçons et filles, à dire, au moment de la consécration : « Prenez et mangez, ceci est mon corps, offert pour vous ». Le corps est ainsi consacré, il devient une chose sacrée, qu'on ne peut plus « jeter en pâture » à sa concupiscence et à celle d'autrui, qu'on ne peut plus vendre, parce qu'il a été donné. Il est devenu eucharistie avec le Christ. L'apôtre Paul écrivait aux premiers chrétiens : « notre corps n'est pas fait pour l'impureté mais pour le Seigneur Jésus... Glorifiez donc Dieu dans votre corps » (1 Co 6, 13.20). Il expliquait aussitôt les deux manières par lesquelles glorifier Dieu dans son corps : ou dans le mariage ou dans la virginité, selon le charisme de la vocation de chacun (cf. 1 Co 7, 1 ss.).
5. Par l'opération de l'Esprit Saint
Où trouver la force, prêtres et laïcs, pour faire cette offrande de soi-même à Dieu, pour se prendre et se soulever, en quelque sorte, de terre avec ses propres mains ? La réponse est l'Esprit Saint ! Le Christ, nous l'avons entendu au début de l'Epître aux Hébreux, s'est offert lui-même en sacrifice « avec un Esprit éternel » (He 9, 14), c'est-à-dire grâce à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui, de même qu'il suscitait dans le coeur humain du Christ l'impulsion de la prière (cf. Lc 10, 21), a aussi suscité en lui l'impulsion et même le désir de s'offrir au Père en sacrifice pour l'humanité.
Le pape Léon XIII, dans son encyclique sur l'Esprit Saint, déclare que « tous les actes du Christ et en particulier son sacrifice, furent accomplis sous l'influence de l'Esprit Saint (praesente Spiritu) » 12 et à la Messe avant la communion, le prêtre prie avec ces paroles : « Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, qui par la volonté du Père et avec la puissance de l'Esprit Saint a donné vie au monde en mourant (cooperante Spiritu Sancto... ». Ce qui explique pourquoi à la Messe il y a deux « épiclèses », c'est-à-dire deux invocations du Saint Esprit : une, avant la consécration, sur le pain et sur le vin, et une, après la consécration, sur l'ensemble du corps mystique.
Avec les paroles d'une de ces épiclèses (Prière eucharistique III), demandons au Père le don de son Esprit pour être à chaque Messe, comme Jésus, à la fois prêtres et sacrifice : « Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les Apôtres, les martyrs, [saint ...] et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous ».
NOTES
1 PO, 2.
2 Didachè, 9-10.
3 Augustin, Confessions, 10,43.
4 Eucharisticum mysterium, 3 ; cf. Augustin, De civitate Dei, X, 6 (CCL 47, 279).
5 Grégoire de Naziance, Oratio 2, 95 (PG 35, 497).
6 Conchita. Journal spirituel d'une mère de famille, par M.-M. Philipon, Desclée De Brouwer 1974, p. 102.
7 Citation de Benoît XVI dans la Lettre pour l'indiction d'une Année sacerdotale.
8 PO, 2.
9 Lumen gentium, 10-11.
10 Piere Chrysologue, Sermo 108 (PL 52, 499 s.).
11Journal, cit., p. 199.
12 Léon XIII, Enc. « Divinum illud munus », 6.
Traduit de l'italien par ZENIT
http://www.cantalamessa.org/fr/predicheView.php?id=343
Prédication du Vendredi saint 2010 Nous avons un grand prêtre souverain
« Nous avons un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu » : ainsi commence le passage de l’Epître aux Hébreux que nous avons entendu en seconde lecture. En cette année sacerdotale, la liturgie du Vendredi saint nous permet de remonter à la source historique du sacerdoce chrétien.
La mort du Christ est la source de deux réalisations du sacerdoce : ministérielle, celle des évêques et des prêtres, et universelle, celle de l’ensemble des fidèles. En effet, cette dernière aussi se fonde sur le sacrifice du Christ qui, dit l’Apocalypse, « nous aime et nous a lavés de nos péchés par son sang, et a fait de nous une Royauté de Prêtres, pour son Dieu et Père » (Ap 1, 5-6). C’est pourquoi, il est vital de comprendre la nature du sacrifice et du sacerdoce du Christ, car c’est d’eux que nous devons, prêtres et laïcs, de façon différente, porter l’empreinte et chercher à vivre les exigences.
L’Epître aux Hébreux explique en quoi consistent la nouveauté et le caractère unique du sacerdoce du Christ, pas seulement par rapport au sacerdoce de l’ancienne alliance, mais aussi – comme nous l’enseigne l’histoire des religions – par rapport à toute autre institution sacerdotale également en dehors de la Bible. « Le Christ, lui, survenu comme un grand prêtre des biens à venir […] entra une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une rédemption éternelle. Si, en effet du sang de boucs et de taureaux et de la cendre de génisse, dont on asperge ceux qui sont souillés, les sanctifient en leur procurant la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par un Esprit éternel s’est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant ! » (He 9, 11-14).
Les autres prêtres offrent tous quelque chose qui se trouve en dehors d’eux-mêmes, le Christ s’est offert lui-même ; les autres prêtres offrent tous des victimes, le Christ, lui, s’est offert en victime ! Saint Augustin a résumé dans une formule célèbre ce nouveau genre de sacerdoce, dans lequel prêtre et victime ne font qu’un : « Ideo sacerdos, quia sacrificium » : prêtre parce que victime »[1].
En 1972, un penseur français lançait la théorie selon laquelle « la violence est le coeur et l’âme secrète du sacré » [2]. A l’origine, en effet, et au centre de toute religion il y a le sacrifice, et le sacrifice comporte destruction et mort. Le journal « Le Monde » saluait cette affirmation, déclarant qu’elle faisait de cette année-là « une année à marquer d’un astérisque dans les annales de l’humanité ». Mais déjà avant cette date, ce savant s’était rapproché du christianisme et, à Pâques 1959, avait rendu publique sa « conversion », se proclamant croyant et revenant à l’Eglise.
Cela lui permit de ne pas s’en tenir, dans ses études suivantes, à la seule analyse de la violence, mais d’indiquer comment en sortir. Beaucoup, hélas, continuent à citer René Girard comme celui qui a dénoncé l’alliance entre le sacré et la violence, mais ne disent rien sur le Girard qui a affirmé que le mystère pascal du Christ a cassé et rompu pour toujours cette alliance. Selon lui, Jésus démasque et brise le mécanisme du bouc émissaire qui sacralise la violence, en se faisant, lui innocent, la victime de toutes les violences[3].
Le processus qui conduit à la naissance de la religion est inversé par rapport à l’explication qu’en avait donnée Freud. Dans le Christ, c’est Dieu qui se fait victime, et non pas la victime (chez Freud, le père primordial) qui, une fois sacrifiée, va être ensuite élevée à la dignité divine (le Père des cieux). Ce n’est plus l’homme qui offre des sacrifices à Dieu, mais Dieu qui se « sacrifie » pour l’homme, en livrant pour lui à la mort son Fils unique (cf. Jn 3, 16). Le sacrifice n’a plus pour fonction d’« apaiser » la divinité, mais plutôt d’apaiser l’homme et de le faire renoncer à son hostilité envers Dieu et envers son prochain.
Le Christ n’est pas venu avec du sang d’autrui, mais avec le sien. Il n’a pas mis ses propres péchés sur les épaules des autres - êtres humains ou animaux - ; il a porté les péchés des autres sur ses épaules : « Lui qui, sur le bois, a porté lui-même nos fautes dans son corps » (1 P 2, 24).
Peut-on encore continuer à parler de sacrifice, à propos de la mort du Christ et donc de la messe ? Pendant longtemps, Girard a refusé ce concept, le jugeant trop marqué par l’idée de violence, mais a fini ensuite par en admettre la possibilité, à condition de voir, dans celui du Christ, un genre nouveau de sacrifice, et de voir dans ce changement de sens « le fait central dans l’histoire religieuse de l’humanité ».
Vu sous cet éclairage, le sacrifice du Christ contient un formidable message pour le monde d’aujourd’hui. Il crie au monde que la violence est un résidu archaïque, une régression à des stades primitifs et dépassés de l’histoire humaine et – s’agissant de croyants – un retard coupable et scandaleux dans la prise de conscience du saut de qualité opéré par le Christ.
Il rappelle aussi que la violence est perdante. Dans quasiment tous les mythes anciens, la victime est le vaincu et le bourreau le vainqueur. Jésus a changé le signe de la victoire. Il a inauguré un nouveau genre de victoire qui ne consiste pas à faire des victimes, mais à se faire victime. « Victor quia victima ! », vainqueur parce que victime, comme Augustin définit le Christ de la Croix[4].
La valeur moderne de la défense des victimes, des faibles et de la vie menacée, est née sur le terrain du christianisme, elle est un fruit tardif de la révolution opérée par le Christ. Nous en avons la contre-preuve. Quand on abandonne (comme l’a fait Nietzsche) la vision chrétienne pour faire revivre la vision païenne, aussitôt cette conquête se perd et l’on en vient à nouveau à exalter « le fort, le puissant, jusqu’à son point sublime, le Surhomme », et à définir la vision chrétienne « une morale d’esclaves », fruit du ressentiment impuissant des faibles contre les forts.
Mais, malheureusement, cette même culture moderne qui condamne la violence, d’un autre côté la favorise et l’exalte. On s’arrache les cheveux de désespoir devant certains faits sanglants, mais sans se rendre compte qu’on prépare le terrain avec la page publicitaire du journal ou la grille des programmes de la télévision. Le plaisir que l’on trouve à s’attarder sur la description de la violence et la compétition à qui sera le premier et le plus cru dans la description ne font que la favoriser. Le résultat n’est pas une catharsis de la violence, mais une incitation à celle-ci. Il est inquiétant de voir que la violence et le sang sont devenus parmi les ingrédients les plus attractifs dans les films et les jeux vidéo, que l’on est attiré par cette violence et que l’on prend plaisir à la regarder.
Le savant mentionné plus haut, René Girard, a mis à nu la matrice d’où provient le mécanisme de la violence : le mimétisme, l’imitation, cette tendance humaine innée à ne considérer désirable que ce que l’autre désire et, donc, à répéter en les imitant les choses que l’on voit les autres faire. La psychologie du « troupeau » est celle qui conduit à choisir un « bouc émissaire » pour trouver, dans le combat contre un ennemi commun – généralement, l’élément le plus faible, celui qui est différent –, une cohésion propre, artificielle et momentanée.
Nous en avons un exemple dans la violence récurrente des jeunes dans les stades, ou dans le harcèlement à l’école et dans certaines manifestations de rue qui ne laissent derrière elles que ruine et destruction. Une génération de jeunes qui a eu le privilège rarissime de ne pas connaître une véritable guerre, de n’avoir jamais été appelés sous les drapeaux, s’amuse (car il s’agit d’un jeu, bien que stupide et parfois tragique) à inventer des guéguerres, poussée par le même instinct qui animait la horde primordiale.
Mais il y a une violence encore plus grave et répandue que celle des jeunes dans les stades et les rues. Je ne parle pas ici de la violence sur des enfants, dont se sont rendus coupables, malheureusement, même des membres du clergé ; de celle-ci, on parle suffisamment ailleurs. Je veux parler de la violence sur les femmes. Elle m’offre l’occasion de faire comprendre aux personnes et aux institutions qui luttent contre cette violence que le Christ est leur meilleur allié.
Il s’agit d’une violence d’autant plus grave qu’elle s’exerce à l’abri des enceintes domestiques, à l’insu de tous, quand elle n’est pas carrément justifiée par des préjugés pseudo religieux et culturels. Les victimes se retrouvent désespérément seules et sans défense. Ce n’est qu’aujourd’hui, grâce au soutien et à l’encouragement de nombreuses associations et institutions, que certaines trouvent la force de sortir à visage découvert et de dénoncer les coupables.
Cette violence est principalement sexuelle. C’est l’homme qui croit prouver sa virilité en s’acharnant contre la femme, sans se rendre compte qu’il ne prouve là que son manque d’assurance et sa lâcheté. Même envers la femme qui a mal agi, quel contraste entre l’attitude du Christ et celle que l'on voit encore dans certains milieux ! Le fanatisme invoque la lapidation ; le Christ, aux hommes qui lui ont présenté une femme adultère, répond : « Que celui d’entre vous qui est sans péché, lui jette le premier une pierre » (Jn 8, 7). L’adultère est un péché qui se commet toujours à deux, mais pour lequel un seul a toujours été (et, dans certaines parties du monde, l’est encore) puni.
La violence contre la femme n’est jamais aussi odieuse que lorsqu’elle s’installe là où devraient régner le respect réciproque et l’amour : dans la relation entre mari et femme. La violence, il est vrai, n’est pas toujours et toute d’un seul côté, elle peut être également verbale et pas seulement avec les mains, mais personne ne peut nier que, dans la grande majorité des cas, la victime est la femme.
Il existe des familles où l’homme s’estime encore autorisé à hausser le ton et lever la main sur la maîtresse de maison. Femmes et enfants vivent parfois sous la menace de la « colère de papa ». A ceux-là, nous devrions dire aimablement : « Chers collègues hommes, en nous créant de sexe masculin, il n’était pas dans l’intention de Dieu de nous donner le droit de nous mettre en colère et de taper du poing sur la table pour des broutilles. La parole adressée à Eve après la faute : « Lui (l’homme) dominera sur toi » (Jn 3, 16), était une amère prédiction, pas une autorisation ».
Jean-Paul II a inauguré la pratique des demandes de pardon pour des torts collectifs. L’une d’elles, parmi les plus justes et nécessaires, est le pardon qu’une moitié de l’humanité doit demander à l’autre : les hommes aux femmes. Cette demande de pardon ne doit pas rester générale et abstraite. Elle doit conduire, notamment ceux qui se disent chrétiens, à des gestes concrets de conversion, à des paroles d’excuse et de réconciliation au sein des familles et de la société.
Le passage de l’Epître aux Hébreux que nous avons entendu se poursuit ainsi : « C’est lui qui, aux jours de sa chair, ayant présenté, avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort ». Jésus a connu dans toute sa cruauté la situation des victimes, les cris étouffés et les larmes silencieuses. Vraiment, « nous n’avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses ». En chaque victime de la violence le Christ revit mystérieusement son expérience terrestre. De même, à propos de chacune d’entre elles, il affirme : « C’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40).
Par une rare coïncidence, cette année-ci notre Pâque tombe la même semaine que la Pâque juive, qui en est l’ancêtre et la matrice au sein de laquelle elle s’est formée. Cela nous incite à avoir une pensée pour nos frères juifs. Ils savent par expérience ce que signifie être victimes de la violence collective et, pour cela aussi, ils sont disposés à en reconnaître les symptômes récurrents. J’ai reçu ces jours-ci la lettre d’un ami juif et, avec son autorisation, je partage avec vous un passage. Voici ce qu’il disait :
« Je suis avec dégoût les attaques violentes et concentriques contre l’Eglise, le Pape et tous les fidèles provenant du monde entier. L'utilisation du stéréotype, le passage de la responsabilité et faute personnelle à celle collective me rappellent les aspects les plus honteux de l’antisémitisme. C’est pourquoi, je désire vous exprimer à vous personnellement, au Pape et à toute l’Eglise, ma solidarité de juif du dialogue et de tous ceux qui dans le monde juif (et ils sont nombreux) partagent ces sentiments de fraternité. Notre Pâque et la vôtre ont des éléments différents indéniables mais elles vivent toutes deux dans l'espérance messianique qui nous réunira sûrement dans l'amour du Père commun. Je vous souhaite donc, à vous, et à tous les catholiques, une Bonne Pâque ».
Nous aussi, catholiques, souhaitons une Bonne Pâque à nos frères juifs. Nous le faisons avec les paroles de leur ancien maître Gamaliel qui, du Seder (repas) pascal juif, sont passées dans la plus ancienne liturgie chrétienne :
« C’est lui qui nous a fait passer
de l’esclavage à la liberté,
de la tristesse à la joie,
du combat à la fête,
des ténèbres à la lumière,
de la servitude à la rédemption »
Pour que nous disions devant lui : Alleluia »[5].
[1] S. Augustin, Confessions, 10,43.
[2] Cf. R. Girard, La violence et le sacré, Grasset, Paris 1972.
[3] M. Kirwan, Discovering Girard, Londres 2004.
[4] S. Augustin, Confessions, 10,43.
[5] Pesachim, X, 5 et Méliton de Sardes, Homélie pascale, 68 (SCh 123, p.98).
Traduit de l'italien par ZENIT
http://www.cantalamessa.org/fr/predicheView.php?id=356
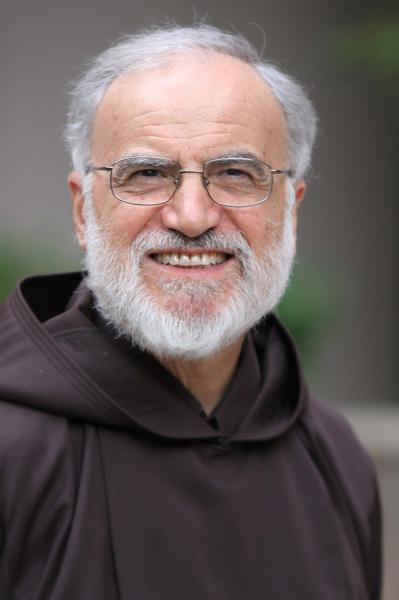 Père Raniero Cantalamessa
Père Raniero Cantalamessa
Prédication du Vendredi Saint 2009 en la Basilique Saint-Pierre : Le Christ s’est fait obéissant pour nous jusqu’à la mort
« Christus factus est pro nobis oboediens usque ad amortem, mortem autem crucis » : « Le Christ s’est fait obéissant pour nous jusqu’à la mort. Et à la mort de la croix ». En ce bimillénaire de la naissance de l’apôtre Paul, écoutons encore quelques unes de ses paroles enflammées sur le mystère de la mort du Christ que nous célébrons. Personne ne saurait mieux que lui nous aider à en comprendre le sens et la portée.
Aux Corinthiens, il écrit en guise de manifeste : « Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, c’est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu » (1 Co 1, 22-24). La mort du Christ a une portée universelle : « Si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts » (2 Co 5, 14). Sa mort a conféré un sens nouveau à la mort de chaque homme et de chaque femme.
Aux yeux de Paul, la croix revêt une dimension cosmique. Sur la croix, le Christ a détruit la barrière de séparation, a réconcilié les hommes avec Dieu et entre eux, en tuant la haine (Ep 2,14-16). Dorénavant, la tradition primitive développera le thème de la croix arbre cosmique qui, avec le bras vertical, unit le Ciel et la terre et, avec le bras horizontal, réconcilie entre eux l’ensemble des peuples du monde. Evénement à la fois cosmique et extrêmement personnel : « Il m’a aimé et s’est livré pour moi » (Ga 2, 20). Tout homme, écrit l’Apôtre, est « celui-là pour qui le Christ est mort » (Rm 14, 15).
De là naît le sentiment de la croix, non plus comme châtiment, reproche ou sujet d’affliction, mais gloire et fierté du chrétien, c’est-à-dire comme une joyeuse certitude, accompagnée d’une gratitude émue, à laquelle l’homme s’élève dans la foi : « Pour moi, que jamais je ne me glorifie sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus Christ » (Ga 6, 14).
Paul a planté la croix au centre de l’Eglise, tel le grand mât au centre du navire ; il en a fait le fondement, le centre de gravité de tout. Il a fixé pour toujours le cadre de l’annonce chrétienne. Les évangiles, écrits après lui, en suivront le schéma, faisant du récit de la Passion et de la mort du Christ l’élément central vers lequel tout est orienté.
On reste abasourdi devant l’entreprise menée à bien par l’Apôtre. Il est relativement facile pour nous, aujourd’hui, de voir les choses dans cette lumière, après que la croix du Christ, comme disait saint Augustin, ait rempli l’univers et brille à présent sur la couronne des rois[1]. Mais au moment où Paul écrivait, la Croix était encore synonyme de la plus grande ignominie, quelque chose que l’on ne devait même pas mentionner entre gens bien élevés.
Le but de l’année paulinienne n’est pas tant de mieux connaître la pensée de l’Apôtre (ceci, les spécialistes le font depuis toujours, sans compter que la recherche scientifique requiert des périodes plus longues qu’un an) ; c’est plutôt, comme le Saint-Père l’a rappelé à plusieurs reprises, d’apprendre de Paul comment faire face aux défis actuels de la foi.
Un de ces défis ouverts, le plus ouvert peut-être jamais encore lancé, s’est traduit dans un slogan publicitaire écrit sur les bus de Londres et d’autres capitales européennes : « Dieu n’existe probablement pas. Cessez donc de vous inquiéter et profitez de la vie » : There’s probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. »
L’élément le plus accrocheur de cette publicité n’est pas tant la prémisse « Dieu n’existe pas », que la conclusion : « Profitez de la vie ! » Le message sous-jacent est que la foi en Dieu empêche de profiter de la vie, qu’elle est ennemie de la joie. Sans la foi, il y aurait davantage de bonheur dans le monde ! Paul nous aide à apporter une réponse à ce défi, en nous expliquant l’origine et le sens de toute souffrance, à partir de celle du Christ.
Pourquoi « fallait-il que le Christ endurât ces souffrances pour entrer dans sa gloire » ? (Lc 24, 26). Une question, à laquelle on apporte parfois une réponse « faible » et, en un certain sens, rassurante. Le Christ, en révélant la vérité de Dieu, suscite nécessairement l’opposition des forces du mal et des ténèbres et celles-ci, comme cela s’était produit avec les prophètes, conduiront à son refus et à son élimination. « Il fallait que le Christ endurât ces souffrances » aurait donc été compris dans le sens qu’« il était inévitable que le Christ endurât ces souffrances ».
Paul donne une réponse « forte » à cette question. La nécessité n’est pas d’ordre naturel, mais surnaturel. Dans les pays qui ont conservé une foi chrétienne ancienne, on associe presque toujours l’idée de souffrance et de croix à celle de sacrifice et d’expiation : la souffrance, pense-t-on, est nécessaire pour expier le péché et apaiser la justice de Dieu. C’est ce qui a provoqué, à l’époque moderne, le rejet de toute idée de sacrifice offert à Dieu et, pour finir, l’idée même de Dieu.
Il est indéniable que nous, les chrétiens, avons parfois prêté le flanc à cette accusation. Mais il s’agit d’un malentendu qu’une meilleure connaissance de la pensée de Paul a désormais définitivement clarifié. Dieu, écrit-il, a exposé le Christ « comme instrument de propitiation » (Rm 3, 25), mais cette propitiation n’agit pas sur Dieu pour l’apaiser, mais sur le péché pour l’éliminer. « On peut dire que Dieu lui-même, pas l’homme, expie le péché... L’image est davantage celle d’une tache corrosive que l’on enlève, ou la neutralisation d’un virus mortel, que celle d’une colère apaisée par la punition »[2].
Le Christ a donné un contenu radicalement nouveau à l’idée de sacrifice. « Ce n’est plus l’homme qui exerce une influence sur Dieu pour l’apaiser. C’est plutôt Dieu qui agit pour que l’homme renonce à son inimitié contre lui et envers le prochain. Le salut ne commence pas avec la demande de réconciliation de la part de l’homme, mais avec l’exhortation de Dieu lui-même : ‘Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20) »[3].
Le fait est que Paul prend le péché au sérieux, il ne le banalise pas. Le péché est, pour lui, la cause principale du malheur des hommes, c’est-à-dire le refus de Dieu, pas Dieu ! Le péché enferme la créature humaine dans le « mensonge » et dans l’« injustice » (Rm 1, 18 ss. ; 3, 23), condamne le cosmos matériel lui-même à la « vanité » et à la « corruption » (Rm 8, 19 ss.) ; il est aussi la cause ultime des maux sociaux qui affligent l’humanité.
On n’en finit pas d’analyser l’actuelle crise économique dans le monde ainsi que ses causes, mais qui ose mettre la hache à la racine et parler de péché ? L’Apôtre définit la cupidité une « idolâtrie » (Col 3, 5) et montre du doigt l’amour démesuré de l’argent comme étant « la racine de tous les maux » (1 Tm 6, 10). Pouvons-nous lui donner tort ? Pourquoi tant de familles sur la paille, de masses de travailleurs sans travail, sinon à cause de la soif insatiable de profit de quelques uns ? L’élite financière et économique mondiale était devenue une locomotive folle emportée dans une course effrénée, sans se soucier du reste du train resté à l’arrêt, à distance sur la voie. Nous marchions tous « à contresens ».
Par sa mort le Christ n’a pas seulement dénoncé et vaincu le péché, il a aussi donné un sens nouveau à la souffrance, y compris à la souffrance qui ne dépend du péché de personne, comme c’est le cas de la souffrance provoquée ces jours derniers dans la région voisine des Abruzzes à cause du terrible tremblement de terre. Il en a fait un instrument de salut, un chemin vers la résurrection et la vie. Son sacrifice agit non pas à travers la mort mais à travers le dépassement de la mort, c’est-à-dire la résurrection. Il a été « livré pour nos fautes » et il est « ressuscité pour notre justification » (Rm 4, 25) : les deux événements sont inséparables dans la pensée de Paul et de l’Eglise.
Il s’agit d’une expérience humaine universelle : dans cette vie, le plaisir et la douleur se succèdent avec la même régularité que l’affaissement et le creux qui avale le naufragé, suit la vague de la mer qui se soulève. « Un je ne sais quoi d’amer – a écrit le poète païen Lucrèce – jaillit du plus profond de chaque plaisir et nous angoisse au cœur des délices »[4]. Le recours à la drogue, l’abus du sexe, la violence homicide, procurent l’ébriété du plaisir sur le moment, mais conduisent à la dissolution morale, et souvent aussi physique, de la personne.
Par sa passion et sa mort, le Christ a renversé le rapport entre plaisir et douleur. « Au lieu de la joie qui lui était proposée, [il] endura une croix » (He 12, 2). Ce n’est plus un plaisir qui se termine dans la souffrance, mais une souffrance qui conduit à la vie et à la joie. Il ne s’agit pas seulement d’une manière différente de se suivre des deux choses ; c’est la joie qui, de cette manière a le dernier mot, non la souffrance, et une joie qui durera éternellement. « Le Christ une fois ressuscité des morts ne meurt plus », « la mort n’exerce plus de pouvoir sur lui » (Rm 6, 9). Et elle n’exercera plus de pouvoir sur nous non plus.
Ce nouveau rapport entre souffrance et plaisir se reflète dans la manière dont la Bible marque le temps. Dans le calcul humain, le jour commence avec le matin et se termine avec la nuit ; pour la Bible il commence avec la nuit et se termine avec le jour : « Il y eut un soir et il y eut un matin : premier jour », dit le récit de la création (Gn 1, 5). Le fait que Jésus soit mort le soir et ressuscité le matin a une signification. Sans Dieu, la vie est un jour qui se termine par la nuit ; avec Dieu c’est une nuit qui se termine par le jour, et un jour sans coucher du soleil.
Le Christ n’est donc pas venu augmenter la souffrance humaine ou prêcher la résignation à la souffrance ; il est venu lui donner un sens et en annoncer la fin et le dépassement. Le slogan sur les bus de Londres et d’autres villes est lu également par des parents qui ont un enfant malade, par des personnes seules, ou qui ont perdu leur travail, par des exilés qui ont fui les horreurs de la guerre, par des personnes qui ont subi de graves injustices dans la vie… J’essaie d’imaginer leur réaction en lisant ces paroles : « Dieu n’existe probablement pas : profite donc de la vie ! » Et avec quoi ?
La souffrance reste certes un mystère pour tous, spécialement la souffrance des innocents, mais sans la foi en Dieu celle-ci devient immensément plus absurde. On lui enlève même son ultime espérance de rachat. L’athéisme est un luxe que seuls les privilégiés de la vie peuvent se permettre, ceux qui ont tout eu, y compris la possibilité de se consacrer aux études et à la recherche.
Ce n’est pas la seule incohérence de cette trouvaille publicitaire. « Dieu n’existe probablement pas » : il pourrait donc exister, on ne peut pas exclure totalement le fait qu’il existe. Mais cher frère non croyant, si Dieu n’existe pas, moi je n’ai rien perdu ; si en revanche il existe, tu as tout perdu ! On devrait presque remercier ceux qui ont promu cette campagne publicitaire ; elle a servi davantage la cause de Dieu que tant de nos arguments apologétiques. Elle a montré la pauvreté de ses raisons et a contribué à réveiller de nombreuses consciences endormies.
Mais Dieu a un mètre de jugement différent du nôtre et s’il voit de la bonne foi ou une ignorance non coupable, il sauve aussi celui qui l’a combattu avec acharnement au cours de sa vie. Nous les croyants devons nous préparer à des surprises dans ce domaine. « Combien de brebis il y a à l’extérieur de la bergerie, s’exclame saint Augustin, et combien de loups à l’intérieur ! » « Quam multae oves foris, quam multi lupi intus ! »[5].
Dieu est capable de faire de ceux qui le nient de la manière la plus acharnée, ses apôtres les plus passionnés. Paul en est la preuve. Qu’avait fait Saul de Tarse pour mériter cette rencontre extraordinaire avec le Christ ? Qu’avait-il cru, espéré, souffert ? A lui s’applique ce que saint Augustin disait de tout choix divin : « Cherche le mérite, cherche la justice, réfléchis et vois si tu trouves autre chose que de la grâce »[6]. C’est ainsi qu’il explique son propre appel : « je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Eglise de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis » (1 Co 15, 9-10).
La croix du Christ est motif d’espérance pour tous et l’année paulinienne une occasion de grâce aussi pour celui qui ne croit pas et est en recherche. Il y a une chose qui parle en leur faveur devant Dieu : la souffrance ! Comme le reste de l’humanité, les athées souffrent aussi dans la vie, et depuis que le Fils de Dieu l’a prise sur soi, la souffrance a un pouvoir de rédemption presque sacramentel. C’est un canal, écrivait Jean-Paul II dans la lettre apostolique « Salvifici doloris »[7], à travers lequel les énergies salvifiques de la croix du Christ sont offertes à l’humanité.
L’invitation à prier « pour ceux qui ne croient pas en Dieu » sera suivie tout à l’heure par une prière touchante, en latin, qui dit : « Dieu éternel et tout puissant, tu as mis dans le cœur des hommes une nostalgie de toi tellement profonde, qu’ils ne sont en paix que lorsqu’ils te trouvent : fais qu’au-delà de tout obstacle, tous reconnaissent les signes de ta bonté et, encouragés par le témoignage de notre vie, qu’ils aient la joie de croire en toi, unique vrai Dieu et Père de tous les hommes. Par le Christ notre Seigneur ».
[1] S. Augustin, Enarr. in Psaumes, 54, 12 (PL 36, 637).
[2] J. Dunn, La teologia dell’apostolo Paolo, Paideia, Brescia 1999, p. 227.
[3] G. Theissen – A. Merz, Il Gesù storico. Un manuale, Queriniana, Brescia 20032, p. 573.
[4] Lucrèce, De rerum natura, IV, 1129 s.
[5] S. Augustin, In Ioh. Evang. 45,12.
[6] S. Agostino, La predestinazione dei santi 15, 30 (PL 44, 981).
[7] Cf. Lettre apostolique “Salvifici doloris”, 23.
Traduit de l’italien par ZENIT
http://www.cantalamessa.org/fr/predicheView.php?id=305
Père Raniero Cantalamessa
Méditation de Careme, Vatican 2006 : «Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance» (Lc 22, 44)
1. Baptisés dans sa mort
Dans les méditations de l’Avent j’ai essayé de montrer combien nous avons aujourd’hui besoin de redécouvrir le kérygme, c’est-à-dire ce noyau originel du message chrétien, en présence duquel naît en général l’acte de foi. La Passion et la mort du Christ représentent l’élément fondamental de ce noyau.
Du point de vue objectif ou de la foi, l’élément significatif est la résurrection et non la mort du Christ : « C’est peu de croire que le Christ est mort, écrit saint Augustin ; les païens, les Juifs, les impies le croient aussi. Tous croient qu’il est mort; la foi chrétienne consiste à croire en sa résurrection ; croire qu’il est ressuscité, c’est donc l’important pour nous » (1). Mais du point du vue subjectif, ou de la vie, l’élément le plus important pour nous est la passion et non la résurrection : « Considérez donc combien sont sacrés ces trois jours du crucifiement, de la sépulture et de la résurrection. Ce que représente le premier de ces trois jours, celui de la croix, c'est ce que nous accomplissons dans la vie présente; mais ce que figurent la sépulture et la résurrection, nous le préparons par la Foi et, l'Espérance », écrit le même saint Augustin (2).
On a écrit que les évangiles sont « des récits de la Passion précédés d’une longue introduction » (M. Köhler). Malheureusement, il s’agit de la partie la plus importante des évangiles et c’est celle qui est le moins mise en valeur au cours de l’année liturgique, puisqu’elle n’est lue qu’une fois par an, pendant la semaine sainte, et qu’en raison de la longueur des rites il est par ailleurs impossible de prendre le temps de l’expliquer et de la commenter. A une certaine époque, la prédication sur la Passion était au centre de toutes les missions populaires ; maintenant que ces occasions sont devenues rares, de nombreux chrétiens arrivent au terme de leur vie sans jamais être montés au Calvaire…
Par nos réflexions sur le Carême nous nous proposons de combler, au moins en partie, cette lacune. Nous voulons demeurer un peu avec Jésus à Gethsémani et sur le Calvaire pour arriver, préparés, à Pâques. Il est écrit qu’à Jérusalem existait une piscine miraculeuse. Le premier qui y plongeait, lorsque les eaux étaient agitées, était guéri. Nous devons maintenant nous jeter, en esprit, dans cette piscine, ou dans cet océan, qu’est la passion du Christ.
Avec le baptême nous avons été « baptisés dans sa mort », « ensevelis avec lui » (cf. Rm 6, 3 s.) : ce qui s’est produit un jour de manière mystique dans le sacrement doit s’accomplir de manière existentielle dans la vie. Nous devons faire un bain salutaire dans la passion, afin d’y être renouvelés, fortifiés, transformés. « Je m’enfouis dans la passion du Christ, écrit la bienheureuse Angela da Foligno, et je reçus l’espérance qu’en elle j’aurais trouvé ma libération » (3).
2. Gethsémani, un fait historique
Notre voyage à travers la Passion commence, comme celui de Jésus, par Gethsémani. L’agonie de Jésus dans le Jardin des oliviers est un fait attesté, dans les évangiles, sur quatre colonnes, c’est-à-dire par les quatre évangélistes. Jean, en effet, en parle également, à sa manière, lorsqu’il met sur les lèvres de Jésus les paroles : « Maintenant mon âme est troublée » (qui rappellent « mon âme est triste » des synoptiques) et les paroles : « Père, sauve-moi de cette heure » (qui rappellent « que cette coupe passe loin de moi » des synoptiques) (Jn 12, 27 s.). La Lettre aux Hébreux – nous le verrons – y fait également écho.
Il est extraordinaire qu’un fait aussi peu « apologétique » ait trouvé une place aussi importante dans la tradition. Seul un événement historique, clairement prouvé, peut expliquer l’importance donnée à ce moment de la vie de Jésus. Les évangélistes ont chacun donné à cet épisode une coloration différente correspondant à leur sensibilité et aux besoins de la communauté pour laquelle ils écrivaient. Ils n’ont cependant rien ajouté de vraiment « étranger » au fait. Chacun d’entre eux a plutôt mis en lumière certaines des applications spirituelles infinies de ce fait. Ils n’ont pas fait, comme on le dit aujourd’hui, de l’eis-egesis, mais de l’ex-egesis.
Les affirmations qui sont, selon la lettre, dans les évangiles, des affirmations en opposition, s’excluant l’une l’autre, ne le sont pas selon l’Esprit. Même s’il n’existe pas de cohérence extérieure et matérielle, il existe une harmonie profonde. Les évangiles sont quatre branches d’un même arbre, dont les ramures sont séparées mais qui sont unies au niveau du tronc (la tradition orale commune de l’Eglise) et, à travers cela, au niveau de la racine qui est le Jésus historique. L’incapacité de nombreux biblistes de voir les choses de cette manière est due à mon avis au fait qu’ils ignorent ce qui se passe dans les phénomènes spirituels et mystiques. Ce sont deux mondes régis par des lois différentes. C’est comme si l’on voulait explorer les corps célestes avec les instruments conçus pour l’exploration sous-marine.
Raymond Brown, éminent exégète catholique, qui a su conjuguer de manière exemplaire la rigueur scientifique et la sensibilité spirituelle dans l’étude de la Bible, résume ainsi le contenu de l’épisode initial de la Passion : « Jésus qui se sépare de ses disciples, l’angoisse de son âme lorsqu’il prie que la coupe s’éloigne de lui, la réponse amoureuse du Père qui envoie un ange pour le soutenir, la solitude du Maître qui par trois fois trouve ses disciples endormis au lieu d’être en train de prier avec lui, le courage exprimé dans la résolution finale d’aller à la rencontre du traître : prise dans les différents évangiles cette combinaison de souffrance humaine, de soutien divin et d’offrande de soi solitaire a beaucoup contribué à faire aimer Jésus par ceux qui croient en lui, devenant un objet d’art, de méditation » (4).
Le noyau originel autour duquel s’est développée toute la scène de Gethsémani semble avoir été celui de la prière de Jésus. Le souvenir d’un combat de Jésus dans la prière juste avant sa Passion plonge ses racines dans une tradition très ancienne, dont dépendent aussi bien Marc que les autres sources (5) et c’est sur cet aspect que nous voulons réfléchir au cours de cette méditation.
Les gestes qu’il accomplit sont les gestes d’une personne qui se débat dans une angoisse mortelle : il se jette « à plat ventre », se lève pour aller vers ses disciples, revient s’agenouiller puis se lève à nouveau… il sue des gouttes de sang (Lc 22, 44). De sa bouche sort la supplication : « Abba, (Père) ! Tout t’est possible : éloigne de moi cette coupe » (Mc 14, 36). La « violence » de la prière de Jésus, alors que sa mort est imminente, ressort surtout dans la Lettre aux Hébreux, où il est dit que du Christ : « C’est lui qui, aux jours de sa chair, ayant présenté, avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort… » (He 5, 7).
Jésus est seul face à la perspective d’une souffrance énorme qui est sur le point de s’abattre sur lui. L’« heure » à la fois attendue et redoutée de l’affrontement final avec les forces du mal, de la grande épreuve (peirasmos) est arrivée. Mais la cause de son angoisse est encore plus profonde : il se sent chargé de tout le mal et de toutes les mauvaises actions du monde. Ce n’est pas lui qui a commis ce mal, mais c’est la même chose car il l’a librement pris sur lui : « il a porté lui-même nos fautes dans son corps » (1 Pt 2, 24), c’est-à-dire (selon le sens de cette expression dans la Bible), dans sa propre personne, à la fois dans son âme, son corps et son cœur. Jésus est l’homme « fait péché », dit saint Paul (2 Co 5, 21).
3. Deux manières différentes de lutter avec Dieu
Pour ôter tout prétexte à l’hérésie arienne, certains Pères anciens expliquèrent l’épisode de Gethsémani en termes pédagogiques, avec l’idée de la « concession » (dispensatio) : Jésus n’a pas vraiment éprouvé de l’angoisse et de la peur, il a seulement voulu nous enseigner comment vaincre nos résistances humaines par la prière. A Gethsémani, écrit saint Hilaire de Poitiers « le Christ n’est pas triste pour lui-même, et ne prie pas pour lui-même mais pour ceux qu’il exhorte à prier avec attention, afin que la coupe de la passion ne menace pas de s’abattre sur eux » (6).
Après Chalcédoine, et surtout après la victoire sur l’hérésie monothélite, on ne ressent plus le besoin de recourir à cette explication. Jésus à Gethsémani ne prie pas seulement pour nous exhorter à prier. Il prie car, étant vrai homme, « éprouvé en tout d’une manière semblable, à l’exception du péché », il fait l’expérience du même combat que nous face à ce qui répugne à la nature humaine (7).
Mais si Gethsémani ne s’explique donc pas uniquement par l’intention pédagogique, il est certain que cette préoccupation était présente à l’esprit des évangélistes qui en ont transmis l’épisode, et il est important pour nous de la recueillir. On ne peut pas, dans les évangiles, séparer le récit du fait de l’appel à l’imitation. « Le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces », dit la Lettre de Pierre (1 P 2, 21).
Le mot « agonie » appliqué à Jésus à Gethsémani (Lc 22, 44) doit être compris dans le sens originel de lutte, plus que dans le sens actuel d’agonie. Le temps où la prière se transforme en lutte, fatigue, agonie, est arrivé. Je ne parle pas à ce moment précis, de la lutte contre les distractions, c’est-à-dire de la lutte avec nous-mêmes ; je parle de la lutte avec Dieu. Ceci se produit lorsque Dieu demande une chose que la nature n’est pas prête à lui donner et lorsque l’action de Dieu devient incompréhensible et déconcertante.
La Bible présente un autre cas de lutte avec Dieu dans la prière et il est très instructif de comparer les deux épisodes. Il s’agit de la lutte de Jacob avec Dieu (cf. Gn 32, 23-33). Le cadre est également très similaire. La lutte de Jacob se déroule la nuit, au-delà d’un torrent – le Yabboq – et celle de Jésus aussi se déroule la nuit, au-delà du torrent du Cédron. Jacob éloigne de lui esclaves, femmes et enfants, pour rester seul, et Jésus également s’éloigne des trois derniers disciples pour prier.
Mais pourquoi Jacob lutte-t-il avec Dieu ? Voilà la grande leçon que nous devons apprendre. « Je ne te lâcherai pas, que tu ne m’aies béni », dit-il, c’est-à-dire, si tu n’as pas fait ce que je te demande. Puis : « Quel est ton nom ? ». Il est convaincu qu’en utilisant le pouvoir donné par le fait de connaître le nom de Dieu, il pourra dominer son frère Laban qui le suit. Toutefois Dieu le bénit mais ne lui révèle pas son nom.
Jacob lutte donc pour faire plier Dieu à sa volonté ; Jésus lutte pour faire plier sa volonté humaine à Dieu. Il lutte car « l’Esprit est ardent mais la chair est faible » (Mc 14, 38). Naturellement, on se demande : à qui ressemblons-nous lorsque nous prions dans des situations difficiles ? Nous ressemblons à Jacob, à l’homme de l’Ancien Testament, lorsque, dans la prière, nous luttons pour pousser Dieu à changer de décision, plus que pour nous changer nous-mêmes et accepter sa volonté ; pour qu’il nous ôte cette croix, plus que pour être en mesure de la porter avec lui. Nous ressemblons à Jésus si, même au milieu des gémissements et de la chair qui sue du sang, nous cherchons à nous abandonner à la volonté du Père. Les résultats des deux prières sont très différents. Dieu ne donne pas son nom à Jacob mais à Jésus il donnera le nom qui est au-dessus de tout nom (cf. Ph. 2, 9).
Parfois, en persévérant dans ce type de prière il arrive une chose étrange qu’il est bon de connaître pour ne pas perdre une occasion précieuse. Les rôles sont inversés : Dieu devient celui qui prie et l’homme celui qui est prié. Nous nous sommes mis en prière pour demander une chose à Dieu et, une fois en prière, nous nous rendons progressivement compte que c’est lui, Dieu, qui nous tend la main, nous demandant quelque chose. Nous sommes allés lui demander d’enlever une épine de notre chair, une croix, une épreuve, de nous délivrer de telle ou telle charge ou situation, de la proximité d’une personne… Et voilà que Dieu nous demande précisément d’accepter cette croix, cette situation, cette charge, cette personne.
Il existe un poème de Tagore qui nous aide à comprendre de quoi il s’agit. C’est un mendiant qui parle et qui raconte son expérience. Il dit plus ou moins ceci : J'étais allé, mendiant de porte en porte, sur le chemin du village lorsqu’un chariot d'or apparut au loin. C’était le chariot du fils du Roi. Je pensai : c’est l’occasion de ma vie et je m’assis en ouvrant toute grande ma besace, attendant que l’on me fasse l’aumône, sans même que je la demande, que les richesses pleuvent sur le sol autour de moi. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque, arrivé près de moi, le chariot s’arrêta, le fils du Roi descendit et tendant la main droite, me dit : « Qu’as-tu à me donner ? » Quel geste royal était-ce là de tendre la main ! Confus et hésitant, je pris un grain de riz dans ma besace, un seul, le plus petit, et je le lui tendis. Mais quelle tristesse, lorsque, le soir, fouillant dans ma besace, je trouvai un grain de riz en or, mais un seul, et le plus petit. Je pleurai amèrement de ne pas avoir eu le courage de tout donner (8).
Le cas le plus sublime de cette inversion des rôles est précisément la prière de Jésus à Gethsémani. Il prie pour que le Père lui ôte la coupe, et le Père lui demande de la boire pour le salut du monde. Jésus ne donne pas une, mais toutes les gouttes de son sang et le Père le récompense en le constituant, également comme homme, Seigneur, si bien qu’« une seule goutte de ce sang suffit maintenant à sauver le monde entier » (una stilla salvum facere totum mundum quit ab omni scelere).
4. « Entré en agonie, il priait de façon plus intense »
Ces paroles ont été écrites par l’évangéliste Luc (Lc 22, 44), avec une claire intention pastorale : montrer à l’Eglise de son temps, soumise désormais elle aussi à des situations de luttes et de persécutions, ce que le maître a enseigné à faire dans de telles circonstances.
La vie humaine est parsemée de tant de petites nuits de Gethsémani. Les causes peuvent être nombreuses et diverses : une menace pour notre santé qui se profile, une incompréhension de notre milieu, l’indifférence de ceux qui nous entourent, la peur des conséquences de quelque erreur commise. Mais il peut y avoir des causes plus profondes : la perte du sens de Dieu, la conscience écrasante de notre péché et de notre indignité, l’impression d’avoir perdu la foi. Ce qu’en fait les saints ont appelés « la nuit obscure de l’esprit ».
Jésus nous enseigne quelle est la première chose à faire dans ces cas : recourir à Dieu à travers la prière. Il ne faut pas se tromper : il est vrai que Jésus à Gethsémani cherche aussi la compagnie de ses amis, mais pourquoi la cherche-t-il ? Non pas pour s’entendre dire de bonnes paroles, pour se distraire ou se faire consoler. Il demande qu’ils soient à ses côtés dans la prière, qu’ils prient avec lui : « Ainsi vous n’avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ! Veillez et priez » (Mt 26, 40)
Il est important de noter de quelle manière débute la prière de Jésus à Gethsémani, dans la source la plus ancienne qu’est l’évangile de Marc : « Abba (père), tout t’est possible » (Mc 14, 36). Le philosophe Kierkegaard fait à ce propos des réflexions très éclairantes. Il dit : « Le point décisif est que pour Dieu tout est possible ». L’homme tombe dans le vrai désespoir seulement quand il n’a plus aucune possibilité, aucune tâche, devant lui, quand, comme on dit, il n’y a plus rien à faire. « Lorsque quelqu’un s’évanouit, on envoie chercher de l’eau de Cologne, des gouttes de Hoffmann ; mais quand quelqu’un tombe dans le désespoir, il faut dire : ‘Trouver une possibilité, trouver lui une possibilité !’ La possibilité est l’unique remède ; donnez lui une possibilité et le désespéré retrouvera son entrain, il reprendra vie, parce que si l’homme reste sans possibilité c’est comme si l’air vient à lui manquer. Parfois la créativité de l’imagination humaine peut suffire pour trouver une possibilité ; mais à la fin, c’est-à-dire quand il s’agit de croire, il ne reste plus qu’une seule chose utile : que pour Dieu tout est possible » (9).
Et cette possibilité, toujours à portée de la main pour un croyant, est la prière. « Prier c’est comme respirer » (10). Et si quelqu’un a déjà prié sans succès ? Qu’il prie encore ! Prier prolixius, avec une plus grande insistance. On pourrait toutefois objecter que Jésus ne fut pas écouté, mais la Lettre aux Hébreux dit exactement le contraire : Il fut « exaucé en raison de sa piété ». Luc exprime cette aide intérieure que Jésus reçoit du Père à travers le détail de l’ange : « Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait » (Lc 22, 43). Mais il s’agit d’une prolepse, d’une anticipation. Le véritable et grand exaucement du Père fut la résurrection du Christ.
Dieu, notait saint Augustin, écoute quand, quand… il n’écoute pas, c’est-à-dire quand nous n’obtenons pas ce que nous demandons. Son retard même à nous exaucer est déjà le fait d’exaucer, pour pouvoir nous donner plus que ce que nous demandons (11). Si malgré tout nous continuons à prier, c’est le signe qu’il nous donne sa grâce. Si Jésus à la fin de la scène déclare, de manière décidée : « Levez-vous, allons ! » (Mt 26, 46) c’est parce que le Père lui a donné plus de « douze légions d’anges » pour le défendre. « Il lui a inspiré la volonté de souffrir pour nous, en infusant en lui la charité » (12).
La capacité de prier est notre grande ressource. De nombreux chrétiens, y compris très engagés, font l’expérience de leur impuissance face aux tentations et de l’impossibilité de s’adapter aux très hautes exigences de la morale évangélique et concluent, parfois, qu’ils n’y arrivent pas et qu’il est impossible de vivre la vie chrétienne totalement. Dans une certaine mesure, ils ont raison. Seuls, il est en effet impossible d’éviter le péché ; il faut la grâce ; mais la grâce – nous est-il enseigné – est gratuite, elle aussi et on ne peut pas la mériter. Que faire alors : désespérer, se rendre ? « En te donnant la grâce, Dieu te commande de faire ce que tu peux et de demander ce que tu ne peux pas faire » dit le Concile de Trente (13).
La différence entre la loi et la grâce est précisément celle-ci : dans la loi, Dieu dit à l’homme : « Fais ce que je te commande ! » ; dans la grâce, l’homme dit à Dieu : « Donne-moi ce que tu m’ordonnes de faire ! ». La loi commande, la grâce demande. Après avoir découvert ce secret, saint Augustin, qui jusqu’alors avait combattu en vain pour être chaste, changea de méthode et au lieu de lutter contre son corps, commença à lutter avec Dieu. Il dit : « Vous m’ordonnez la continence; donnez-moi ce que vous m’ordonnez, et ordonnez-moi ce qu’il vous plaît (14) ». Et nous savons qu’il obtint la chasteté.
Jésus a donné par avance à ses disciples le moyen et les paroles pour s’unir à lui dans l’épreuve, le Notre Père. Il n’existe aucun état d’âme ne pouvant se refléter dans le « Notre Père » et qui ne trouve en lui la possibilité de se traduire en prière : la joie, la louange, l’adoration, l’action de grâce, le repentir. Mais le « Notre Père » est surtout la prière du temps de l’épreuve. Il existe une ressemblance évidente entre la prière que Jésus laissa à ses disciples et celle qu’il éleva lui-même au Père à Gethsémani. Il nous a en réalité laissé, sa prière.
La prière de Jésus commence comme le Notre Père, par le cri : « Abba, Père » (Mc 14, 36) ou « Mon Père » (Mt 26, 39) ; elle se poursuit, comme le Notre Père, en demandant que sa volonté soit faite ; il demande que la coupe passe loin de lui, comme dans le Notre Père nous demandons d’être « délivrés du mal » ; il dit à ses disciples de prier pour ne pas entrer en tentation et nous fait conclure le Notre Père par les paroles : « Ne nous soumets pas à la tentation ».
Quel réconfort, à l’heure de l’épreuve et des ténèbres, de savoir que l’Esprit Saint continue en nous la prière de Jésus à Gethsémani, que les « gémissements ineffables » avec lesquels l’Esprit intercède pour nous, à ces moments-là, parviennent au Père mêlés aux « invocations et supplications présentées avec une violente clameur et des larmes » (cf. He 5, 7).
5. En agonie jusqu’à la fin du monde
Nous devons retenir un dernier enseignement avant de prendre congé du Jésus de Gethsémani. Saint Léon le Grand dit que « la passion du Christ se prolonge jusqu’à la fin des siècles » (15). Le philosophe Pascal lui fait écho dans la célèbre méditation sur l’agonie de Jésus :
« Jésus sera en agonie jusqu’à la fin du monde : il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Je pensais à toi dans mon agonie, j’ai versé telles gouttes de sang pour toi. Veux-tu qu’il me coûte toujours du sang de mon humanité, sans que tu donnes des larmes ? Je te suis plus ami que tel et tel ; car j’ai fait pour toi plus qu’eux, et ils ne souffriraient pas ce que j’ai souffert de toi et ne mourraient pas pour toi dans le temps de tes infidélités et cruautés, comme j’ai fait et comme je suis prêt à faire et fais dans mes élus au Saint Sacrement (16).
Tout cela n’est pas une simple façon de parler ou un forçage psychologique ; cela correspond mystérieusement à la vérité. Dans l’Esprit, Jésus est en cet instant également à Gethsémani, dans le prétoire, sur la croix. Et pas seulement dans son corps mystique – en celui qui souffre, est emprisonné ou tué – mais, d’une manière que nous ne pouvons pas expliquer, également dans sa personne. Ceci est vrai, non pas « en dépit » de la résurrection mais précisément « à cause » de la résurrection qui a rendu le Crucifix « vivant pour les siècles ». L’Apocalypse nous présente l’Agneau au ciel, « debout », c’est-à-dire ressuscité et vivant, mais avec les signes encore visibles de son immolation (cf. Ap 5, 6).
Le lieu privilégié où nous pouvons rencontrer ce Jésus « en agonie jusqu’à la fin du monde » est l’Eucharistie. Jésus l’institua juste avant de se rendre au Jardin des Oliviers afin que ses disciples puissent, à n’importe quelle époque, devenir « contemporain » de sa Passion. Si l’Esprit nous inspire le désir de passer une heure aux côtés de Jésus à Gethsémani pendant ce Carême, le moyen le plus simple de le faire est de passer, le jeudi soir, une heure devant le Saint Sacrement.
Ceci ne doit bien sûr pas nous faire oublier l’autre manière par laquelle le Christ « est en agonie jusqu’à la fin du monde », c’est-à-dire à travers les membres de son corps mystique. Et d’ailleurs, si nous voulons concrétiser nos sentiments à son égard, le chemin obligé est précisément de faire à l’un d’eux ce que nous ne pouvons faire avec lui, qui est dans la gloire.
Le mot « Gethsémani » est devenu le symbole de toute souffrance morale. Jésus n’a encore subi aucun tourment physique ; sa peine est uniquement intérieure, et pourtant il ne sue du sang que là, lorsque son cœur – et pas encore sa chair – est écrasé. Le monde est très sensible aux souffrances corporelles, il s’en émeut facilement ; il est beaucoup moins sensible aux souffrances morales, dont il se moque même parfois, en les confondant avec de l’hypersensibilité, de l’autosuggestion, des lubies.
Dieu prend la souffrance du cœur très au sérieux et nous devrions faire de même. Je pense à qui voit se briser le lien le plus fort qu’il possédait dans la vie et se retrouve seul (le plus souvent, seule) ; je pense à celui qui est trahi dans ses affections, angoissé face à une chose qui menace sa vie ou celle d’une personne qui lui est chère ; à celui qui, à tort ou à raison (il n’y a pas beaucoup de différence de ce point de vue), se voit montré du doigt, d’un jour à l’autre, et devient la risée de tous. Combien de Gethsémani sont cachés dans le monde, peut-être sous notre propre toit, derrière la porte du voisin, chez celui qui se trouve à la table de travail d’à-côté ! A nous d’en trouver pendant ce Carême et de nous faire proches de celui qui s’y trouve.
Que Jésus ne doive pas dire en ses membres : « J’espérais la compassion, mais en vain, des consolateurs, et je n’en ai pas trouvé » (Ps 68, 21), mais qu’il puisse en revanche nous faire entendre au fond du cœur la parole qui récompense tout : « C’est à moi que vous l’avez fait ».
NOTES
(1) Discours sur les psaumes, Psaume 120, 6 (cf. http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/psaumes/index.htm)
(2) In Œuvres complètes de Saint Augustin traduites pour la première fois en français sous la direction de M. Poujoulat et de M. l’abbé Raulx, Bar-Le-Duc 1864, Tome I, p. 519-561 ; Tome II ; Tome III, p. 1-123 http://www.abbaye-saint benoit.ch/saints/augustin/lettres/index.htm
(3) Il libro della B. Angela da Foligno, Quaracchi, Grottaferrata 1985, p. 148.
(4) R. E. Brown, The Death of the Messiah. From Gethsemane to the Grave. A Commentary on the Passion Narratives in the Four Gospels, I, Doubleday, New York, 1994, p. 216.
(5) Brown, p. 233.
(6) Cf. St Hilaire de Poitiers, De Trinitate, X, 37.
(7) Cf. St Maxime le Confesseur, In Mattheum 26, 39 (PG 91, 68).
(8) Tagore, Gitanjali, 50 (trad. ital. Newton Compton, Roma 1985, p. 91).
(9) S. Kierkegaard, La malattia mortale, parte I, C, (Opere, a cura di C. Fabro, pp. 639 ss.
(10) Ib. p. 640
(11) St Augustin, Sulla Prima lettera di Giovanni, 6, 6-8 (PL 35, 2023 s.).
(12) St Thomas d’Aquin, Summa theologiae, III, q. 47, a. 3.
(13) Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, n. 1536.
(14) St Augustin, Confessions, X, 29.
(15) St Léon le Grand, Sermo 70, 5: PL 54, 383
(16) B. Pascal, Pensées, GF-Flammarion, 1976, n. 553
[Texte original : italien – Traduction réalisée par Zenit]
http://www.cantalamessa.org/fr/predicheView.php?id=135
Méditation de Careme, Vatican 2006: Il apprit de ses souffrances, l’obéissance
1. Sacrifice ou obéissance
On ne peut pas embrasser l’océan, mais on peut faire mieux, on peut se laisser embrasser par lui, en s’immergeant à n’importe quel endroit de son étendue. Ainsi en est-il de la Passion du Christ. On ne peut l’embrasser entièrement en esprit, ni en voir le fond ; mais l’on peut s’immerger dans la Passion en partant de l’une de ses étapes. Au cours de cette méditation nous voulons y entrer par la porte de l’obéissance.
L’obéissance du Christ est l’aspect de la Passion mis le plus en évidence par la catéchèse apostolique. « Obéissant jusqu’à la mort et à la mort sur une croix » (Ph 2 , 8) ; « par l’obéissance d’un seul, la multitude sera (…) constituée juste » (Rm 5, 19) ; « Tout Fils qu’il était, [il] apprit, de ce qu’il souffrit, l’obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel » (He 5, 8-9). L’obéissance apparaît comme une clé de lecture de toute l’histoire de la Passion, à partir de laquelle elle prend tout son sens et toute sa valeur.
A qui se scandalisait du fait que le Père puisse trouver satisfaction dans la mort sur la croix de son fils Jésus, saint Bernard répondait à juste titre : « Ce n’est pas la mort qui lui plut mais la volonté de celui qui spontanément, mourait » : « Non mors placuit sed voluntas sponte morientis » (1). Ce n’est donc pas tant la mort du Christ elle-même qui nous a sauvés, mais bien plus son obéissance jusqu’à la mort.
Dieu veut l’obéissance et non le sacrifice, dit l’Ecriture (Cf. 1 S 15, 22 ; He 10, 5-7). Il est vrai que dans le cas du Christ Il veut aussi le sacrifice, et Il le veut de notre part également ; mais de ces deux choses, l’une est le moyen, l’autre la fin. Dieu veut l’obéissance pour elle-même ; le sacrifice, Il ne le veut qu’indirectement, comme la condition qui seule rend l’obéissance possible et authentique. C’est dans ce sens que la Lettre aux Hébreux dit que « le Christ apprit l’obéissance de ce qu’il souffrit ». La Passion fut la preuve et la mesure de son obéissance.
Essayons de voir en quoi consiste l’obéissance du Christ. Jésus, alors qu’il était enfant obéissait à ses parents ; plus tard, devenu adulte, il se soumit à la loi de Moïse ; au cours de la Passion il se soumit à la sentence du sanhédrin, de Pilate… Mais le Nouveau Testament ne fait référence à aucun de ces types d’obéissance ; il fait référence à l’obéissance du Christ au Père. Saint Irénée interprète l’obéissance de Jésus, à la lumière des carmes du Serviteur, comme une soumission intérieure, absolue à Dieu, réalisée dans une situation d’extrême difficulté :
« Et ce péché auquel le bois avait donné naissance a été effacé par le bois de l'obéissance, sur lequel a été cloué le Fils de l'homme, obéissant à Dieu; ainsi, en abolissant la science du mal, il a introduit et distribué la science du bien. Et comme le mal est de désobéir à Dieu, obéir à Dieu est le bien. … par l'obéissance qu'il a pratiquée jusqu'à la mort en étant attaché sur le bois, il a expié l'antique désobéissance provoquée par le bois » (2).
L’obéissance de Jésus s’exerce, de manière particulière, sur les paroles qui sont écrites sur lui et pour lui « dans la loi, les prophètes et les psaumes ». Quand ils veulent s’opposer à son arrestation, Jésus dit : « Comment alors s’accompliraient les Ecritures d’après lesquelles il doit en être ainsi ? » (Mt 26, 54).
2. Dieu peut-il obéir ?
Mais comment peut-on concilier l’obéissance du Christ avec la foi dans sa divinité ? L’obéissance est un acte de la personne, non de la nature, et la personne du Christ, selon la foi orthodoxe, est celle du Fils même de Dieu. Dieu peut-il obéir à lui-même ? Nous touchons ici au noyau le plus profond du mystère christologique. Essayons de voir en quoi consiste ce mystère.
A Gethsémani Jésus dit au Père : « Pourtant, pas ce que je veux mais ce que tu veux » (Mc 14, 36). Le problème consiste entièrement dans le fait de savoir qui est ce « je » et qui est ce « tu » ; qui prononce le fiat et à qui il le dit. Dans les temps anciens, deux réponses sensiblement différentes, selon le type de christologie sous-jacent, furent données à ces questions.
Pour l’école d’Alexandrie, le « je » qui parle est la personne du Verbe qui, en tant que personne incarnée, dit son « oui » à la volonté divine (le « tu ») que lui-même a en commun avec le Père et l’Esprit Saint. Celui qui dit « oui » et celui auquel il dit « oui » sont la même volonté, considérée toutefois en deux temps ou en deux états différents : dans l’état de Verbe incarné et dans l’état de Verbe éternel. Le drame (si l’on peut parler de drame) se déroule davantage en Dieu qu’entre Dieu et l’homme et ceci parce que l’existence en Jésus Christ d’une volonté humaine et libre n’est pas encore pleinement reconnue.
L’interprétation de l’école d’Antioche est plus valide, sur ce point. Pour qu’il puisse y avoir obéissance, affirment les auteurs de cette école, il convient qu’il y ait un sujet qui obéit et un sujet auquel on obéit : personne n’obéit à lui-même ! L’obéissance du Christ étant par ailleurs l’antithèse de la désobéissance d’Adam, celle-ci doit nécessairement être l’obéissance d’un homme, le Nouvel Adam, capable en tant que tel de représenter l’humanité. Voilà donc qui sont ce « je » et ce « tu » : le « je » est l’homme Jésus, le « tu » est Dieu auquel il obéit !
Mais cette interprétation comportait elle aussi une grave lacune. Si le fiat de Jésus à Gethsémani est essentiellement le « oui » d’un homme, même si celui-ci est uni de manière indissoluble au Fils de Dieu (l’homo assumptus), comment cela peut-il avoir une valeur universelle en mesure de « rendre justes » tous les hommes ? Jésus apparaît davantage comme un modèle sublime d’obéissance que comme une « cause de salut » intrinsèque à tous ceux qui lui obéissent (cf. He 5, 9).
Le développement de la christologie a permis de combler cette lacune, surtout grâce à l’œuvre de saint Maxime le Confesseur et du Concile de Constantinople III. Saint Maxime affirme : le « je » n’est pas l’humanité qui parle à la divinité (école d’Antioche) ; ce n’est pas non plus Dieu qui, en tant que personne incarnée, parle à lui-même en tant qu’éternel (école d’Alexandrie). Le « je » est le Verbe incarné qui parle au nom de la volonté humaine libre qu’il a assumée ; le « tu » en revanche est la volonté trinitaire que le Verbe a en commun avec le Père.
En Jésus, le Verbe obéit humainement au Père ! Et cependant le concept d’obéissance ne disparaît pas, et Dieu, dans ce cas, n’obéit pas non plus à lui-même, car entre le sujet et le terme de l’obéissance il y a toute l’épaisseur d’une humanité réelle et d’une volonté humaine libre (3).
Dieu a obéi humainement ! On comprend alors la puissance universelle de salut enfermée dans le fiat de Jésus : il s’agit de l’acte humain d’un Dieu ; d’un acte divin-humain, théandrique. Ce fiat est véritablement, pour reprendre l'expression d'un psaume, « le rocher de notre salut » (Ps 95, 1). C’est par cette obéissance que « tous ont été rendus justes ».
3. L’obéissance à Dieu dans la vie chrétienne
Cherchons, comme toujours, à tirer de cela un enseignement pratique pour notre vie, en rappelant l’avertissement de la Première lettre de Pierre : « Le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces ». Réfléchir à l’obéissance peut contribuer à créer le climat spirituel juste dans l’Eglise, chaque fois que l’on se trouve face à l’éventualité d’un changement de personnes et de poste de travail.
Dès que l’on se met à chercher, à travers le Nouveau Testament, en quoi consiste le devoir de l’obéissance, on découvre une chose surprenante : l’obéissance est presque toujours vue comme obéissance à Dieu. On parle certes aussi de toutes les autres formes d’obéissance : aux parents, aux patrons, aux supérieurs, aux autorités civiles, « à toute institution humaine » (1 P 2, 13), mais beaucoup moins souvent et de manière beaucoup moins solennelle. Le substantif même d’« obéissance » est utilisé toujours et uniquement pour indiquer l’obéissance à Dieu ou, en tout cas, à des instances qui sont du côté de Dieu, sauf dans un seul passage de la Lettre à Philémon où il indique l’obéissance à l’Apôtre.
Saint Paul parle d’obéissance à la foi (Rm 1, 5 ; 16, 26), d’obéissance à l’enseignement (Rm 6, 17), d’obéissance à l’Evangile (Rm 10, 16 ; 2 Th 1, 8), d’obéissance à la vérité (Ga 5, 7), d’obéissance au Christ (2 Cor 10, 5). Nous trouvons ce même langage ailleurs également : les Actes des Apôtres parlent d’obéissance à la foi (Ac 6, 7), la Première Lettre de Pierre parle d’obéissance au Christ (1 P 1, 2) et d’obéissance à la vérité (1 P 1, 22).
Mais est-il possible et cela a-t-il un sens de parler aujourd’hui d’obéissance à Dieu, après que la volonté nouvelle et vivante de Dieu, manifestée en Jésus Christ, se soit entièrement accomplie et concrétisée dans toute une série de lois et de hiérarchies ? Est-il légitime de penser qu’il existe encore, après tout cela, des volontés « libres » de Dieu à recueillir et à accomplir ?
On n’est en mesure de comprendre la nécessité et l’importance de l’obéissance à Dieu que si l’on croit à une « Seigneurie » actuelle et ponctuelle du Ressuscité sur l’Eglise, que si l’on est profondément convaincu qu’aujourd’hui également – comme le dit le psaume – « Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre… » et rompt son silence ! (cf. Ps 49 (50)). Elle consiste à se mettre à l’écoute du Dieu qui parle, dans l’Eglise, à travers son Esprit, qui éclaire les paroles de Jésus et de toute la Bible et leur donne une autorité, en en faisant des voies de la volonté vivante et actuelle de Dieu pour nous.
Mais étant donné que dans l’Eglise, institution et mystère ne sont pas en opposition mais sont unis, nous devons maintenant montrer que l’obéissance spirituelle à Dieu ne détourne pas de l’obéissance à l’autorité visible et institutionnelle mais au contraire la renouvelle, la renforce, la vivifie, au point que l’obéissance aux hommes devient le critère pour discerner l’existence ou non de l’obéissance à Dieu et son caractère authentique.
L’obéissance à Dieu est comme « le fil venu d’en haut » qui soutient la splendide toile d’araignée suspendue à une haie. En descendant le long d’un fil qu’elle-même produit, l’araignée construit sa toile, parfaite et bien tendue à chaque angle. Cependant, ce fil venu d’en haut qui a servi à construire la toile n’est pas coupé une fois l’œuvre terminée ; c’est au contraire lui qui, du centre, soutient toute la toile tissée ; sans lui, tout s’affaisse. Si l’on détache un fil latéral l’araignée se remet à l’ouvrage et répare rapidement sa toile, mais si l’on coupe le fil qui vient d’en haut, elle s’éloigne ; elle sait qu’il n’y a plus rien à faire.
Il se produit quelque chose de semblable à propos du « fil » de l’autorité et de l’obéissance dans une société, un ordre religieux, dans l’Eglise. L’obéissance à Dieu est le fil venu d’en haut : tout s’est construit à partir de cette obéissance ; mais on ne peut l’oublier, pas même une fois que la construction est terminée. Si on l’oublie, cela provoque une crise et l’on finit même par affirmer, comme ce fut le cas il y a quelques années : « l’obéissance n’est plus une vertu ».
Mais pourquoi est-il aussi important d’obéir à Dieu ? Pourquoi Dieu tient-il autant au fait que nous lui obéissions ? Certes pas pour le plaisir de commander et d’avoir des sujets ! Cela est important car en obéissant nous faisons la volonté de Dieu, nous voulons ce que Dieu veut et réalisons ainsi notre vocation originelle qui est d’être « à son image et ressemblance ». Nous sommes dans la vérité, dans la lumière et par conséquent dans la paix, comme le corps qui a atteint son repos. Dante Alighieri a condensé tout cela dans un vers considéré par beaucoup comme le plus beau de toute la Divine Comédie : « En sa volonté est notre paix » (4).
4. Obéissance et autorité
Obéir à Dieu est une chose que nous pouvons toujours faire. Nous n’obéissons en revanche que quelques fois, trois ou quatre fois dans toute une vie, à des ordres et des autorités visibles (je parle bien sûr d’actes d’obéissance sérieux) ; mais les actes d’obéissance à Dieu sont nombreux. Plus on obéit, plus les ordres de Dieu se multiplient, car Il sait que c’est le plus beau don qu’il puisse faire, celui qu’Il fit à son Fils bien-aimé, Jésus.
Lorsque Dieu trouve une âme décidée à obéir il prend sa vie en main, comme on prend le gouvernail d’un bateau, ou les rênes d’un char. Il devient concrètement, et pas seulement en théorie, « Seigneur », c’est-à-dire celui qui « régit », qui « gouverne » déterminant d’une certaine manière, instant après instant les gestes, les paroles de cette personne, sa manière d’utiliser son temps, tout.
Cette « direction spirituelle » s’exerce à travers les « bonnes inspirations » et plus souvent encore à travers les paroles de Dieu de la Bible. En lisant ou écoutant des passages de l’Ecriture, une phrase, une parole s’illumine et devient en quelque sorte, radio-active. Nous sentons qu’elle nous interpelle, qu’elle nous indique ce que nous devons faire. C’est là que se décide si l’on obéit ou non à Dieu. Le Serviteur de Yahvé dit oui dans Isaïe : « il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j’écoute comme un disciple » (Is 50, 4). Nous aussi chaque matin, dans la liturgie des heures ou de la Messe, nous devrions avoir l’oreille attentive. Dans la liturgie se trouve presque toujours une parole que Dieu nous adresse personnellement et l’Esprit ne manque pas de nous la faire reconnaître parmi toutes les autres.
J’ai dit qu’obéir à Dieu est une chose que l’on peut toujours faire. Je dois dire que c’est aussi une chose que nous pouvons tous faire, aussi bien les personnes subordonnées que les supérieurs. On a l’habitude de dire qu’il faut savoir obéir pour pouvoir commander. Il ne s’agit pas seulement d’une affirmation empirique ; il existe une profonde raison théologique à la base de cette affirmation si par obéissance nous entendons l’obéissance à Dieu.
Lorsqu’un ordre est donné par un supérieur qui s’efforce de vivre selon la volonté de Dieu, qui a prié auparavant et n’a que le bien de son frère à défendre et aucun intérêt personnel, l’autorité même de Dieu vient renforcer cet ordre ou cette décision. Si cela donne lieu à une contestation, Dieu dit à son représentant ce qu’il a dit un jour à Jérémie : « Voici que moi, aujourd’hui même, je t’ai établi comme ville fortifiée, colonne de fer et rempart de bronze (…) ils lutteront contre toi mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi » (Jr 1, 18 ss.).
Un exégète anglais célèbre fournit une interprétation éclairante de l’épisode du centurion dans l’Evangile. « Moi, dit le centurion, qui n’ai rang que de subalterne, j’ai sous moi des soldats et je dis à l’un : va ! et il va, et à un autre : Viens ! et il vient, et à mon esclave : Fais ceci ! et il le fait » (Lc 7, 8). Du fait de sa soumission, c’est-à-dire de son obéissance à ses supérieurs et, en définitive à l’empereur, le centurion peut formuler des ordres qui ont derrière eux l’autorité de l’empereur en personne ; ses soldats lui obéissent car il obéit à son tour et est soumis à son supérieur.
Les choses se déroulent également de cette manière, pense-t-il, avec Jésus, vis-à-vis de Dieu. Du moment qu’il est en communion avec Dieu et obéit à Dieu, il a derrière lui l’autorité même de Dieu et peut par conséquent commander à son serviteur de guérir et celui-ci guérira, il peut commander à la maladie de le quitter et celle-ci le quittera (5).
C’est la force et la simplicité de cet argument qui suscite l’admiration de Jésus et lui fait dire de ne jamais avoir trouvé autant de foi en Israël. Le centurion a compris que l’autorité de Jésus et ses miracles découlent de sa parfaite obéissance au Père, comme Jésus lui-même, du reste, explique dans l’Evangile de Jean : « et celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît » (Jn 8, 29).
L’obéissance à Dieu ajoute à l’autorité, le poids, c’est-à-dire un pouvoir réel et efficace, pas un pouvoir purement nominal, lié à la fonction, mais un pouvoir en quelque sorte ontologique, pas seulement juridique. Saint Ignace d’Antioche donnait ce merveilleux conseil à l’un de ses collègues dans l’épiscopat : « Que rien ne se fasse sans ton consentement mais toi, ne fais rien sans le consentement de Dieu » (6).
Ceci ne signifie pas que l’on atténue l’importance de l’institution ou de la charge, ou que l’on fait dépendre l’obéissance du subalterne uniquement du degré d’autorité spirituelle et du poids du supérieur, ce qui serait, de toute évidence, la fin de toute obéissance. Cela signifie seulement que celui qui exerce l’autorité doit se baser le moins possible, ou uniquement en dernière instance, sur le titre ou sur la charge qu’il possède et le plus possible sur l’union de sa volonté avec celle de Dieu, c’est-à-dire sur son obéissance ; le subalterne en revanche ne doit pas juger ou prétendre savoir si la décision du supérieur est ou non conforme à la volonté de Dieu. Il doit présumé qu’elle l’est, à moins qu’il s’agisse d’un ordre qui va manifestement contre sa conscience, comme cela se produit parfois dans le domaine politique, sous les régimes totalitaires.
C’est le même principe que pour le commandement de l’amour. Le premier commandement reste le « premier » commandement, car la source et le mobile de tout sont l’amour de Dieu ; mais le critère pour juger est le second commandement : « Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas » (1 Jn 4, 20). On doit dire la même chose de l’obéissance : celui qui n’obéit pas aux représentants visibles de Dieu sur la terre, comment peut-il dire qu’il obéit à Dieu qui est au ciel ?
5. Présenter les questions à Dieu
Cette voie de l’obéissance à Dieu n’a rien, en soi, de mystique et d’extraordinaire. Elle est ouverte à tous les baptisés. Elle consiste à « présenter les questions à Dieu », selon le conseil que Ietro donna un jour à Moïse, son gendre (cf. Ex 18, 19). Je peux décider seul de prendre une initiative, d’entreprendre ou non un voyage, un travail, de faire une visite, une dépense et, une fois la décision prise, prier Dieu pour que tout se passe bien. Mais si l’amour de l’obéissance en Dieu naît en moi, je procéderai de manière différente : je demanderai d’abord à Dieu, avec le moyen très simple de la prière, si sa volonté est que je fasse ce voyage, ce travail, cette visite, cette dépense, puis je le ferai, ou non, mais il s’agira dans un cas comme dans l’autre d’un acte d’obéissance à Dieu, et non plus d’une initiative libre et personnelle.
Il est clair que je n’entendrai normalement aucune voix au cours de ma brève prière, et que je ne recevrai aucune réponse explicite sur ce que je dois faire ou en tout cas, il n’est pas nécessaire que je la reçoive pour que ce que je fasse soit en obéissance à Dieu. En faisant cela, en effet, j’ai soumis la question à Dieu, je me suis dépouillé de ma volonté, j’ai renoncé à décider seul et j’ai donné à Dieu une possibilité d’intervenir, s’il le souhaitait, dans ma vie. Indépendamment de ce que je déciderai alors de faire, en me basant sur les critères ordinaires de discernement, je ferai un acte d’obéissance à Dieu.
De même qu’un serviteur fidèle ne prend jamais un ordre ou ne répond jamais à une initiative venant d’une personne étrangère sans dire : « Je dois d’abord savoir ce qu’en pense mon maître », le vrai serviteur de Dieu n’entreprend rien sans se dire à lui-même : « Je dois prier un peu pour savoir ce que mon Seigneur veut que je fasse ! ». On cède ainsi les rênes de sa vie à Dieu ! La volonté de Dieu pénètre ainsi de plus en plus profondément dans le tissu de notre vie, en l’enrichissant et en faisant d’elle un « sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu » (Rm 12, 1). Toute la vie devient une obéissance à Dieu et proclame silencieusement sa souveraineté sur l’Eglise et sur le monde.
Dieu – disait saint Grégoire le Grand – « nous enseigne tantôt par ses paroles, tantôt par ses œuvres », c’est-à-dire avec les événements et les situations (7). Il y a une forme d’obéissance à Dieu, souvent parmi les plus exigeantes, qui consiste tout simplement à obéir aux situations. Lorsque l’on constate que, malgré tous les efforts et les prières, des situations difficiles, parfois même absurdes, et à notre sens spirituellement contre-productives, persistent et ne changent pas, il faut cesser de « regimber contre l’aiguillon » et commencer à voir dans ces situations la volonté silencieuse mais résolue de Dieu sur nous. L’expérience montre que ce n’est parfois que lorsque nous avons prononcé un « oui » total et du profond du cœur à la volonté de Dieu que ces situations de souffrance perdent le pouvoir angoissant qu’elles ont sur nous. Nous les vivons avec davantage de paix.
Un cas difficile d’obéissance aux situations est celui qui s’impose à tous, avec l’âge, c’est-à-dire le retrait de l’activité, la cessation du travail, le fait de devoir passer les consignes à d’autres, laissant peut-être des projets et des initiatives en cours, inachevés. Quelqu’un a dit, en plaisantant, que la charge de supérieur est une croix, mais que parfois la chose la plus difficile à accepter n’est pas le fait de monter sur la croix mais d’en descendre, d’être déposé de la croix !
Il n’y a pas lieu, certes, d’ironiser à propos d’une situation délicate, face à laquelle personne ne sait comment il réagirait, tant qu’il n’y est pas passé. Il s’agit de l’une des formes d’obéissance qui se rapprochent le plus de celle du Christ au cours de sa Passion. Jésus a suspendu son enseignement, il a interrompu toute activité, il ne s’est pas laissé retenir par la pensée de ce qui serait advenu à ses apôtres ; il ne s’est pas préoccupé de savoir ce qui serait advenu de sa parole, confiée, comme elle l’était, uniquement à la pauvre mémoire de quelques pêcheurs. Il ne s’est pas non plus attardé à la pensée de sa Mère qu’il laissait seule. Aucune plainte, aucune tentative de faire changer de décision au Père. Pour que « le monde reconnaisse que j’aime le Père et que je fais comme le Père m’a commandé. Levez-vous ! Partons d’ici ! » (cf. Jn 14, 31).
6. Marie, l’obéissante
Avant de conclure nos considérations sur l’obéissance, contemplons un instant l’icône vivante de l’obéissance, celle qui non seulement a imité l’obéissance du Serviteur, mais l’a vécue avec lui. Saint Irénée écrit : « Parallèlement au Seigneur, on trouve aussi la Vierge Marie obéissante, lorsqu'elle dit ‘Voici ta servante, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole’. … Car de même qu'Eve, en désobéissant, devint cause de mort pour elle-même et pour tout le genre humain, de même Marie, … devint, en obéissant, cause de salut pour elle-même et pour tout le genre humain » (8). Marie entre dans la réflexion théologique de l’Eglise (nous sommes en effet en présence de la première ébauche de Mariologie), à travers le titre d’obéissante.
Marie a certainement aussi obéi à ses parents, à la loi, à Joseph. Mais ce n’est pas à ces formes d’obéissance qu’a pensé saint Irénée, mais à son obéissance à la parole de Dieu. Son obéissance est l’antithèse parfaite de la désobéissance d’Eve. Mais – encore une fois – à qui Eve a-t-elle désobéi pour être appelée désobéissante ? Pas à ses parents, qu’elle n’avait pas, ou à son mari ou une quelconque loi écrite. Elle a désobéi à la parole de Dieu ! De même que le « Fiat » de Marie se place en parallèle, dans l’Evangile de Luc, au « Fiat » de Jésus à Gethsémani (cf. Lc 22. 42), pour saint Irénée, l’obéissance de la nouvelle Eve se place en parallèle à l’obéissance du nouvel Adam.
Marie aura certainement récité ou écouté, au cours de sa vie terrestre, le verset du psaume dans lequel on dit à Dieu : « Enseigne-moi à faire tes volontés » (Ps 142, 10). Nous lui adressons la même prière : « Enseigne-nous, Marie, à faire la volonté de Dieu comme tu l’as fait » !
NOTES
(1) St Bernard de Clairveau, De errore Abelardi, 8, 21 (PL 182, 1070).
(2) St Irénée, La prédication des Apôtres et ses preuves, 34.
(3) St Maxime le Confesseur, In Matth, 26, 39 (PG 91, 68).
(4) Dante Alighieri, Divine Comédie, Paradis, Chant III, v. 85 (Ed. du Cerf)
(5) Cf. C.H. Dodd, Il fondatore del cristianesimo, Leumann 1975, p. 59 s.
(6) St Ignace d’Antioche, Lettre à Polycarpe, 4, 1.
(7) St Grégoire le Grand, Homélies sur les Evangiles, 17, 1 (PL 76, 1139).
(8) St Irénée, Adv. Haer. III, 22, 4.
[Texte original : italien – Traduction réalisée par Zenit]
Date de dernière mise à jour : 2018-04-03
Ajouter un commentaire